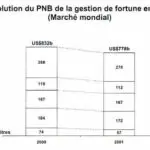Un industriel à la Banque centrale

Mais que fait donc la Banque centrale européenne ?
Elle aurait déjà dû baisser ses taux directeurs depuis longtemps même si, comme le rappelle M. Duisenberg, elle n’est pas là pour se soucier, selon ses statuts, de la croissance.
Aucun membre de la Banque centrale européenne ni aucune personnalité civile ne fait référence à une éventuelle baisse.
Sitôt que Romano Prodi parle en termes critiques du pacte de stabilité, les opérateurs des marchés se disent déboussolés et s’inquiètent et l’un des seuls à défendre cette position est le ministre de l’Économie, M. Francis Mer, un industriel.
Ces deux exemples récents permettent de saisir a posteriori l’intérêt de la présence d’un industriel au sein du Conseil de la Politique monétaire de la Banque de France1. Cela a été mon cas pendant les six années de mon mandat, et je voudrais ici expliquer l’utilité des approches plus concrètes caractéristiques du monde de l’entreprise, et souvent ignorées par notre haute administration, et les banquiers centraux.
Je voudrais également aborder ici les points de la politique monétaire pour lesquels la culture entrepreneuriale a un réel apport dans les organismes où les aspects de croissance croisent les problèmes financiers. J’exposerai la manière dont j’ai perçu les logiques au sein de la Banque de France, puis ce qui transparaît du fonctionnement de la Banque centrale européenne. Mais avant cela il me faut revenir sur deux points qui conditionnent le développement économique :
1) la nécessité de l’endettement pour le monde industriel et de ce que toute croissance économique vigoureuse va de pair avec une politique monétaire expansive ;
2) les logiques des financiers et des entrepreneurs s’opposent : pour les premiers l’argent est une fin et a une existence en lui-même, pour les seconds c’est un moyen pour d’autres objectifs.
Les analyses que j’expose correspondent à ma sensibilité ; elles sont sans doute parfois subjectives mais elles ont toujours été confrontées à la réalité.
Développement économique et logique des acteurs
L’importance du développement de l’endettement
Quel que soit le pays, quel que soit son système économique, le développement des activités n’est qu’un gigantesque pari sur l’avenir, même dans les entreprises existantes. Quel que soit le pays, quel que soit son système économique, la totalité des paris doivent être réussis en nombre suffisant pour que les emprunts, pour les uns, les prêts, pour les autres, soient remboursés avec une rentabilité des capitaux investis supérieure aux taux réels. Or tous les paris ne pourront pas réussir. Les réussites devront donc payer pour les échecs si l’on veut que le pays se développe, ce que, à ma connaissance, tous les gouvernements de gauche ou de droite recherchent.
En d’autres termes, la rentabilité moyenne ex post doit être égale à la rentabilité prévue ex ante majorée d’un coefficient proportionnel au taux d’échec. Contrairement à l’idée répandue mais fausse, pour développer l’emploi, il faut accroître le taux de profit des réussites2 afin de compenser les conséquences des échecs inévitables. La dette et sa rentabilisation sont le nœud du développement.
Selon une autre approche, plus historique, on constate que les périodes de croissance sont allées de pair avec la mise sur les marchés financiers de nouveaux instruments financiers. La décennie 80 avec Pierre Bérégovoy en France avait été particulièrement » inventive » même si l’essentiel venait de l’adaptation des pratiques anglo-saxonnes et a conduit à l’expansion de la fin de la décennie.
De la même manière la politique monétaire expansive menée en France à partir de 1996 a permis de bénéficier en 1997, 1998, 1999 et 2000 de taux de croissance tout à fait exceptionnels. Mais tout nouvel instrument financier, quelle que soit la manière d’envisager les choses, recouvre une seule réalité : un accroissement de l’endettement. Les seules nouveautés, qui leur valent, à ce titre, quelques succès, résident dans l’organisation de la répartition du profit et toujours par l’accroissement de la part réservée au financier en cas de succès au détriment de l’économie tout entière en cas d’échec3.
L’exemple du fonds LTCM4, auquel appartenaient deux prix Nobel d’économie, MM. Merton et Scholes, est à cet égard particulièrement clair. Avec une mise initiale de quatre milliards de dollars, les gains en période faste étaient du même ordre de grandeur. Mais avec la crise thaïlandaise et le retournement des marchés, la perte globale aurait dû être d’une centaine de milliards de dollars que les acteurs auraient été bien en peine de couvrir. Pour couvrir ce risque, la Federal Reserve Bank (la collectivité) est intervenue pour injecter des liquidités.
Si l’on se réfère aux périodes passées, on constate toujours que le développement des moyens monétaires (soit par la sous-évaluation de la monnaie, soit par la baisse des taux d’intérêt) a toujours été à l’origine du développement économique. Le développement est parfois interrompu par un krach comme celui que nous vivons en 2001 et 2002, non pas en raison de l’importance de la masse monétaire mais parce que l’ensemble des projets financés a une rentabilité insuffisante.
L’opposition des logiques des chefs d’entreprise et des banquiers
Si donc, comme je le pense, et comme les faits m’en convainquent, la croissance économique est d’autant plus vive que l’on peut s’endetter, pourquoi y a‑t-il interruption brutale de la croissance économique ? À notre sens, l’opposition entre les logiques internes aux structures bancaires et aux structures économiques joue un rôle central en rendant possible le financement de projets à la rentabilité aléatoire.
1) La logique du chef d’entreprise
Ce qui lui importe, c’est la rentabilité des capitaux investis, quelle que soit l’origine de ces capitaux. En effet cette rentabilité doit être supérieure au taux moyen des ressources.
Par nature le chef d’entreprise cherche à investir et doit donc s’endetter5. Il promet pour cela une rentabilité future. Cette approche est la seule valable pour progresser et lorsqu’elle a été possible pour beaucoup d’entreprenants, elle a permis les périodes de forte croissance.
2) La logique du banquier
Le banquier prête. Il prête sur des fonds qui ne lui appartiennent pas, mais surtout il prête ce que la Banque centrale lui permet de prêter. Plus les taux de refinancement sont bas, plus il peut prêter. L’endettement intérieur total augmente. Cette augmentation de l’EIT assure à elle toute seule la croissance de l’activité.
Jusque-là rien que de très banal, mais comment prêter, à qui prêter, quels projets soutenir. Par définition, le banquier ne croit à rien de précis, sinon il serait chef d’entreprise et mettrait en œuvre son projet. Il est donc obligé de se référer à un certain nombre de critères (qualité des hommes, passé de l’entreprise, etc.).
3) L’opposition des logiques
Nous avons donc d’un côté un homme qui croit à un projet, qui sait le vendre et qui est habité par une vision du futur, de l’autre un homme écartelé entre la volonté de développer la possession de signes monétaires, la crainte de passer à côté de bonnes affaires, et le risque inhérent à des activités qu’il comprend d’autant plus mal qu’elles doivent être plus innovantes pour réussir.
Durant les périodes où les évolutions techniques ou sociologiques sont lentes, le système bancaire se révèle grosso modo adapté. Avec le temps les critères de sélection des différents projets économiques se dégagent. En revanche pendant les périodes d’évolution rapide les anciens critères ne signifient plus rien. Ainsi l’Internet, les changements sociaux liés à la mondialisation et la socialisation toujours aggravée de l’économie ont, en quelques années, bouleversé les perspectives et rendent plus difficile la sélection des projets des entrepreneurs.
C’est dans ce cadre que la » mode » fait des ravages en finançant des activités qui ne mériteraient pas de l’être (souvenons-nous de ces dot.com aux services totalement gratuits, et financées alors qu’elles n’avaient aucun espoir de rentabilité) et en tuant les activités sérieuses plus longues à se mettre en place et qui arrivent dès lors trop tard.
Il me faut cependant signaler que cette opposition est beaucoup plus vive en Europe où les deux mondes de la banque et de l’entreprise s’interpénètrent peu, qu’aux États-Unis. La Fed, ainsi que le pouvoir politique, est imprégnée de microéconomie, et lors de mes déplacements à Washington, j’ai mesuré à quel point la vision était différente. J’avais l’impression d’être en phase avec les organismes de la Fed, alors que j’avais le plus grand mal à Paris à faire prendre ces approches en considération. D’ailleurs je n’attribue pas à d’autre cause les succès de la politique monétaire de M. Greenspan dans les années quatre-vingt-dix.
La logique de la Banque de France
L’opposition entre banque et entreprise est déjà difficile à surmonter, mais cet obstacle devient carrément infranchissable dès lors que la Banque centrale se comporte en » banque des banques « , et n’a l’œil rivé que sur deux indicateurs :
- la force de la monnaie,
- l’inflation.
Sur ces deux termes là encore, les logiques s’opposent.
La force de la monnaie
Pour la quasi-totalité de la Banque de France, et de la Banque centrale européenne, la force de la monnaie (le franc puis l’euro) se mesure par son pouvoir d’achat extérieur. Sur ce point l’accord est total. La divergence vient de ce que, pour un industriel, le pouvoir d’achat vient de l’échange. On peut valablement soutenir qu’une monnaie est d’autant plus forte qu’elle est sous-valorisée, améliorant ainsi les capacités d’échange6. Sans aller jusqu’à la sous-valorisation, une valorisation correcte autorise une politique monétaire plus expansive favorable à la rentabilité des activités.
Seul Wim Duisenberg a émis, en début de mandat, des opinions de ce style qui lui permettaient de ne pas s’alarmer de la dépréciation de l’euro et on l’a traité de gaffeur.
Qui ne voit que la valorisation de l’euro à 0,88 dollar a été un fantastique atout, pour la croissance, pour la cohésion monétaire de l’Europe, et la réussite de l’euro ?
Pour des raisons symétriques, l’appréciation de l’euro va introduire des germes de tensions entre tous les pays d’Europe alors même que les facteurs d’ajustements monétaires n’existent plus et que la flexibilité est mise à mal par les politiques socialisantes.
L’inflation
De fait le problème posé par la dérive des prix, dont il faut à l’évidence combattre les excès, devrait être vu de manière moins dogmatique. La Banque de France s’impose des contraintes qui n’ont pas lieu d’être. Ainsi :
Les Banques centrales tentent toujours de justifier leur rôle par la menace de résurgence de l’inflation, mais très souvent elles crient » au loup » plus pour se justifier qu’en raison du danger. Il est vrai que dans nos pays où les rigidités sociales ont été aggravées, ce risque n’est pas nul car notre potentiel de croissance a été réduit à quelque 1,5 à 2 %.
La conséquence en est que toute croissance supérieure à cette valeur nous serait interdite, même si nous savons parfaitement qu’avec ce taux le chômage ne peut que croître.
Pour la Banque de France et la Banque centrale européenne il faut freiner la croissance avant même qu’elle ait tendance à repartir.
1) J’ai toujours pensé que nous devrions ignorer l’inflation importée, c’est-à-dire celle qui vient du coût de l’énergie, du coût des matières premières et surtout du coût des produits importés. Peu nous importe que les produits chinois augmentent, au contraire c’est un atout pour nous. Que le prix du pétrole augmente est sans inconvénient parce que l’augmentation est la même pour tous.
2) Il est également néfaste de penser que l’on doive limiter l’inflation à 2 % maximum. Cette valeur, en effet beaucoup trop faible, surtout en période de mutation rapide de l’économie, n’est pas souhaitable. L’économie bouge, et il existe toujours à un moment ou à un autre des raretés et des rigidités (par exemple administratives), qui accroissent le niveau des prix. Vouloir maintenir à tout prix une inflation inférieure à 2 % peut conduire à faire peser sur le système productif privé (le seul qui a fait la preuve de sa capacité à accroître la productivité) un poids beaucoup trop lourd. Ainsi une moyenne à 1,5 % oblige l’industrie à faire baisser ses prix de 5 à 10 %, et la croissance indispensable de la productivité pour atteindre cette moyenne est de même ampleur. Elle est impensable sur une longue période.
On voit bien dès lors comment ces deux conceptions s’opposent. L’une est celle du rentier qui souhaite maintenir son pouvoir d’achat national et international et pour qui la monnaie est un objectif en soi. Pour l’industriel que je suis, la rente ne m’importe que dans la mesure où elle me permet de mesurer mon efficacité. La conséquence macroéconomique du comportement des entrepreneurs est que l’efficacité maximale sera obtenue dans la mesure où tout le potentiel productif de la nation aura été valorisé.
La Banque centrale européenne
Le Conseil de la Politique monétaire de la Banque de France a su pendant toute une période tirer profit des approches aussi différenciées mais complémentaires. Trois à quatre de ses membres avaient acquis ces convictions par la pratique ou par le contact avec le monde de l’entreprise, voire même par une approche universitaire fondée sur l’observation. Il existait donc, au sein du Conseil, un certain équilibre des positions et un réel souci de favoriser l’activité dans un cadre permettant aussi de limiter l’inflation. Il est vrai que nous avons été aidés par la remontée du dollar à partir de novembre 1996 à la suite des débats de novembre 1996 sur les tensions au sein du SME en liaison avec la sous-évaluation du dollar à cette époque.
Depuis l’arrivée de l’euro en 1999, la politique monétaire au niveau européen est menée par l’instance qui regroupe les membres du directoire de la Banque centrale européenne ainsi que les gouverneurs des banques centrales. Ces hommes et ces femmes ont tous une culture bancaire et souvent celle-là seulement. Le statut d’indépendance donné aux gouverneurs ne permet même pas aux Conseils nationaux, dans la conception de Maastricht, d’aborder ces notions, de faire valoir ces autres opinions et surtout d’en tenir compte.
On en a une illustration récente. Alors que la croissance n’est plus au rendez-vous de la conjoncture et que l’euro s’est réapprécié par rapport au dollar, la politique monétaire aurait dû regagner en expansivité par les taux, ce qu’elle avait perdu avec les changes. Cela fait donc au moins six mois que les taux de refinancement de la Banque centrale européenne, à l’instar des taux américains, auraient dû baisser. Nous sommes encore à 3,25 % alors qu’ils sont à 1,75 % aux États-Unis. Nous aurions évité une partie de la dépréciation des valeurs d’actifs en particulier boursiers7, et peut-être limité la casse.
Si la BCE avait agi ainsi, elle aurait été mieux armée pour critiquer les gouvernements sur leur politique budgétaire. Il est quand même étonnant que J.-C. Trichet et la Banque centrale européenne, si prompts à accuser les déficits actuels pour 2004, aient été aussi peu diserts lorsque le Gouvernement français a, en 1999 et 2000, affecté des recettes conjoncturelles à des dépenses structurelles8. N’en déplaise aux banquiers centraux et aux marchés, Romano Prodi a parfaitement raison de dire que le pacte de stabilité est stupide. Stupide il l’est pour trois raisons :
- la première est qu’il ne tient aucun compte de la conjoncture. De fait, les budgets nationaux devraient être obligatoirement en excédent si l’activité est élevée. Personne n’a fait cet effort en période de haute conjoncture, trop soucieux de dépenser une » cassette « , pour des raisons électorales. L’absence de référence à l’activité dans le pacte est totalement illogique ;
- les pénalités prévues aggraveraient le phénomène qu’elles sont censées punir (comme si on accélérait encore une voiture dont les freins chauffent) ;
- il est également stupide car le déficit signifie que l’on recourt à l’endettement. Or s’endetter n’est pas en soi critiquable. Mais on ne doit s’endetter que pour préparer le futur et investir. Cela est normal et souhaitable si les projets financés sont suffisamment rentables.
Malheureusement les pays d’Europe s’endettent pour payer les dépenses de fonctionnement et des investissements à rentabilité par trop négative (SNCF, inefficacité de l’Éducation nationale) sans préparer le futur (démographie, défense, etc.).
Au fond Romano Prodi lève le voile sur une réalité, et on l’accuse de gaffer. Il se comporte comme ceux qui sont au contact des réalités humaines.
Au-delà des divergences nées de la conception politique de l’avenir, la présence de personnalités du monde de l’industrie ou très proches a été un incontestable enrichissement pour la Banque de France et pour la politique monétaire française.
Je crois que la diversité des expériences et surtout l’opposition de certains d’entre nous aux schémas et aux représentations véhiculés par l’administration et la Banque centrale ont été très utiles. Aujourd’hui, la Banque centrale européenne a reproduit la conception antérieure sans avoir en face d’elle une autorité politique qui lui apporterait une autre vision ni sans avoir en son sein des personnalités capables d’apporter un autre éclairage.
La Bundesbank, la Banque de France indépendante, la Banque du Japon et la Banque d’Angleterre ont ou avaient un pouvoir politique en face d’elles et elles doivent ou devaient en tenir compte. Rien de cela pour la Banque centrale européenne. Francis Mer a en face de lui l’édredon mou de l’Europe monétaire qui justifie la politique monétaire de Paris par un risque d’inflation virtuelle que ferait peser sur l’euro la hausse des prix à Bari, Valladolid ou Dublin, pesant pourtant très peu dans l’univers européen.
J’ai tenté ici en quelques lignes de montrer ce que mon expérience a pu apporter, et l’analyse que j’ai pu faire, des oppositions que j’ai constatées. Bien évidemment les schémas et les représentations ont été simplifiés pour les rendre plus clairs.
Le poids politique de la vision rentière de l’économie s’est accru au détriment de la vision favorable au développement, et les choix de politique monétaire s’en ressentent. J’y vois là une des conséquences néfastes, voire mortelles pour notre continent, du vieillissement de sa population, qui cherche à conserver les signes monétaires du capital qu’elle croit avoir accumulé, sans comprendre que ce capital ne vaut que par la santé et le développement de l’économie. Il est indispensable que dans notre pays les voix plus favorables au développement se fassent de nouveau entendre.
La différence de richesse entre Européens et Américains qui s’était resserrée se réaccroît aujourd’hui, et nous finançons le bien-être de la génération actuelle par des traites sur l’avenir. Nous avons, à mon sens, trop tardé pour réagir. Intervenir pour que la politique monétaire de la Banque centrale européenne intègre ces considérations serait un premier pas.
_____________________________________________
1. A contrario on saisit le manque qui se manifeste aujourd’hui au niveau de la Banque centrale européenne, dont le Conseil est exclusivement bancaire.
2. Je rappelle que seules les réussites sont visibles.
3. Cela a été vrai avec la Compagnie des Indes, la tulipomania, etc. Voir les analyses de Galbraith.
4. Long Term Capital Management. Il s’agit d’un Hedge Fund dont la notoriété vint de la participation de MM. Merton et Scholes, prix Nobel d’économie 1997, grâce à leurs travaux sur les produits dérivés, la spécialité de LTCM. Le modèle mis au point fonctionnait remarquablement à la hausse mais ne prévoyait pas de retournement possible.
5. On doit considérer que tous les capitaux d’une entreprise doivent être rémunérés comme s’il s’agissait d’endettement auprès du système bancaire.
6. L’opinion publique relaie d’ailleurs ce point de vue, car à quoi sert d’avoir une monnaie sur- valorisée, si du coup 12 % de la nation (les chômeurs) est interdite d’échange.
7. Quand les taux baissent, la valeur des actifs augmente.
8. CMU, 35 heures, etc., cela avait déjà été le cas dans la période 1987–1990.