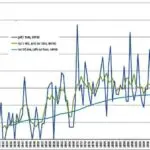Quelques X dans l’affaire Dreyfus

ANDRÉ Louis, Joseph, Nicolas (1857)
ANDRÉ Louis, Joseph, Nicolas (1857)
Louis André naquit le 29 mars 1838 à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or) de Nicolas André, négociant et Joséphine Charles, sans profession. Il fit ses études au lycée de Dijon puis au collège Sainte-Barbe avant d’intégrer l’École polytechnique en 1857, où il eut comme condisciple le futur président Sadi Carnot. Sa fiche signalétique établie par l’École indique qu’il était châtain clair, yeux bleus, visage ovale, qu’il mesurait 1,79 m et qu’il avait une cicatrice au front (comme Harry Potter ?).
Entré 54e de sa promotion, il en sortit 60e sur 102 en 1859 et fut envoyé à l’École d’application de l’artillerie à Metz avec le rang de sous-lieutenant. Il fut nommé en 1861 lieutenant en second au 9e régiment d’artillerie et capitaine en second en 1867.
Il fit la guerre de 1870 à l’École de pyrotechnie et à la Commission d’expériences de Bourges puis au 7e régiment d’artillerie à Rennes puis à Paris. Il prit part aux combats de Champigny et du Bourget et fut nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1871.
Il épousa en 1876 Marguerite Chapuy, artiste dramatique et lyrique à succès, qui renonça au théâtre et au chant après son mariage.
Il fut nommé chef d’escadron en 1877 au 34e régiment d’artillerie, lieutenant-colonel en 1885 à Grenoble, général de brigade en 1893, commandant de l’École polytechnique de 1894 à 1896, officier de la Légion d’honneur en 1895, général de division commandant la 10e division en 1899.
En mai 1900, alors qu’il était en manœuvres à Nemours, Waldeck-Rousseau, président du Conseil, l’appela à la suggestion de Maurice Ephrussi pour succéder comme ministre de la Guerre au général de Galliffet qui n’avait duré que onze mois à ce poste très exposé où il resta plus de quatre ans, un record pour l’époque.
André avait alors la réputation d’un républicain intransigeant et d’un anticlérical notoire. À peine nommé, il procéda à une épuration de l’armée. C’est ainsi que les généraux Alfred Delanne (X 1862), chef d’état-major général et Édouard Jamont (X 1850), général en chef en temps de guerre, ainsi que de nombreux chefs de bureau de l’état-major furent relevés de leurs fonctions. André essaya à plusieurs reprises en 1900, 1902, 1903, de faire voter des lois permettant de réintégrer Picquart, sans succès. Les esprits étaient encore trop échauffés.
En décembre 1900, pendant les débats sur la loi d’amnistie, André déféra le commandant Cuignet devant un conseil d’enquête et le punit de soixante jours de forteresse pour une lettre relative à un article sur le « faux Cuignet ».
En juin 1902, le cabinet anticlérical du « petit père » Combes succéda à Waldeck-Rousseau. André resta à la Guerre. En avril 1903, à la suite d’un long discours de Jaurès demandant à la Chambre la révision du procès de Dreyfus, André accepta au nom du gouvernement de faire une enquête qui fut dite « préliminaire ». André était sans préjugés mais il n’était pas convaincu de l’innocence de Dreyfus. Il confia l’enquête au commandant Antoine Louis Targe (X 1885). Celle-ci confirma officiellement que le dossier de Rennes comprenait notamment des témoignages suspects et des pièces matériellement altérées. Ce fut le premier pas vers la 2e révision.
André fut alors convaincu de l’innocence de Dreyfus. Il considéra que sa tâche était de prendre la défense des officiers républicains, dont la carrière avait souffert du fait de leur prise de position dans l’Affaire, contre les attaques des éléments réactionnaires. À cet effet, il confia à son chef de cabinet le général Percin et son ordonnance le capitaine Mollin, membre du Grand Orient, la constitution d’un système de fiches relatant les opinions politiques et religieuses des officiers. 25 000 fiches furent ainsi constituées à l’aide d’informations transmises par la hiérarchie militaire quelquefois aidée par les francs-maçons.
La découverte de certaines fiches par deux députés nationalistes, Guyot de Villeneuve et Gabriel Syveton, mit le feu aux poudres. En octobre 1904, ces derniers attaquèrent violemment André à la Chambre des députés, l’accusant d’avoir instauré un système de délation et utilisé les fiches pour décider de la carrière des intéressés et allant jusqu’à le frapper. Malgré l’appui de Jaurès, il dut démissionner en novembre 1904, entraînant le gouvernement Combes dans sa chute. Il fut remplacé par Maurice Berteaux, qui dura à peine plus de six mois.
André se retira alors dans la Côte-d’Or où il était conseiller général du canton de Gevrey-Chambertin depuis 1902. En juillet 1906, après l’arrêt de la Cour de cassation, il écrivit à Dreyfus : « Je n’ai pas à vous dire le grand plaisir que m’ont causé coup sur coup l’arrêt de la Cour et les séances du Parlement. » Il demanda au ministre que la Légion d’honneur soit remise à Dreyfus dans la grande cour de l’École militaire, mais l’intéressé préféra la petite cour et André ne fut même pas invité. Il publia ses mémoires en 1907 (Cinq ans de ministère). En juin 1908, à la suite de l’attentat contre Dreyfus lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, il lui écrivit : « Vous avez rempli votre devoir avec la résolution et le courage qui ne vous ont jamais abandonné… » Il fut candidat malheureux au conseil municipal de Nuits en 1908 et au Sénat en 1910. Il mourut en 1913 à Dijon.
BERNARD Claude Maurice (1882)
Claude Maurice Bernard naquit le 24 septembre 1864 à Paris de Jules Édouard Bernard, comptable et Léonide Geneviève Genet, sans profession. Il entra à l’École polytechnique à 18 ans dans la promotion 1882. Sa fiche signalétique établie par l’École indique qu’il était châtain, yeux gris, visage large, qu’il mesurait 1,67 m et qu’il n’avait pas de signes particuliers.
Entré à l’X 8e sur 247, il en sortit 4e en 1884 et choisit le corps des Mines. Il fut d’abord affecté au service des Mines de Béziers puis « pantoufla » à la Société des mines et fonderies de la Canette (Aude) et devint ingénieur-conseil de la Société des mines et fonderies de Pontgibaud. Il fit des missions d’exploration en 1896 en Guyane puis en 1897 au service des Mines de l’Imerina à Madagascar où on le retrouve en 1907 comme ingénieur-conseil de la société Le graphite français1.
Bernard fut un des signataires des deux premières pétitions des « intellectuels » de janvier 1898 demandant la révision du procès de 1894 (resp. 13e et 12e listes) ainsi que de la protestation en faveur de Picquart (7e liste).
Bernard fut cité comme témoin de la défense au procès de Rennes en août 1899, pour réfuter les thèses abracadabrantes et pseudo-scientifiques d’Alphonse Bertillon tendant à prouver que Dreyfus était le scripteur du « bordereau ».
Bernard écrivit le 2 septembre au courrier des lecteurs du journal La Paix pour rectifier une affirmation parue dans La Libre Parole qui le présentait comme Juif : « Par simple respect de la vérité, j’ai écrit à M. Drumont pour m’excuser de ne pas l’être (juif) et je concluais ainsi : Je n’appartiens donc pas à la race ni à la religion qu’honore un Mathieu Dreyfus. »
Les calculs de Bernard furent utilisés par Henri Poincaré (X 1873) dans son avis sur le travail de Bertillon, lu devant le Conseil de guerre par Paul Painlevé, professeur de mécanique à l’X. L’avis de Poincaré se terminait ainsi : «… En résumé, les calculs de M. Bernard sont exacts ; ceux de M. Bertillon ne le sont pas… »
Bernard intervint à nouveau dans le cadre de la révision du procès de Rennes. Il publia dans Le Siècle en avril 1904 une série d’articles qui furent ensuite réunis en une brochure intitulée Le bordereau, explications et réfutations du système de M. A. Bertillon et de ses commentateurs. Une réplique fut publiée en juin par L’Action française puis diffusée sous forme d’une brochure verte intitulée La théorie de M. Bertillon, réponse à MM. Bernard, Molinier et Painlevé, par un polytechnicien. Ce polytechnicien, encore inconnu aujourd’hui, a tenu à garder l’anonymat, preuve que le vent commençait enfin à tourner !
Bernard mourut en mars 1923.
________________
1. André Thépot, Les ingénieurs des Mines du XIXe siècle, histoire d’un corps technique d’État, tome I, 1910–1914, Éditions ESKA, Paris, 1998.
CARVALLO Julien (1883)
Julien Carvallo naquit le 5 janvier 1866 à Paris de Jacob Jules Carvallo, (X 1840), ingénieur des Ponts et Chaussées et Élodie Sara Rodrigues, sans profession. Il entra à l’École polytechnique à 17 ans dans la promotion 1883, soit cinq ans après Dreyfus, à la suite de ses deux frères Joseph (X 1873) et Moïse Emmanuel (X 1877)2. Sa fiche signalétique établie par l’École indique qu’il avait les cheveux noirs, yeux gris, visage allongé, qu’il mesurait 1,74 m et qu’il n’avait pas de signes particuliers.
Entré à l’X 14e sur 227, il en sortit 4e en 1885 et choisit l’artillerie dont il fit l’école d’application.
Il fut nommé capitaine en décembre 1894, d’abord adjoint à la manufacture de Châtellerault, puis au 22e régiment d’artillerie de Versailles3. C’est de là qu’il envoya une carte à Dreyfus après l’arrêt de la Cour de cassation : « Très heureux de l’arrêt de la Cour de cassation, sincères félicitations. »
Le capitaine Carvallo déposa au procès de Rennes en septembre 1899 ; il s’y attacha à démontrer qu’en 1894 on ne prenait aucune précaution pour tenir secret le matériel de 120 court. Sa carrière en souffrit pendant des années, comme celle de la plupart de ceux qui avaient osé défendre la vérité mais il n’avait aucun état d’âme à ce sujet, comme il l’écrivit le 9 janvier 1900 à Louis Havet, professeur au Collège de France et membre du Comité central de la ligue des Droits de l’homme, témoin au même procès : « Ma cause est juste et je crois posséder la vérité… »4
Le 15 juillet 1906, au lendemain de la cassation sans renvoi, Carvallo écrivit à Joseph Reinach pour le féliciter, ajoutant : «… Sans me poser en victime, depuis deux ans je vois mettre au tableau des camarades plus jeunes et passer commandants des officiers qui m’ont tourné le dos parce que témoin au procès de Rennes… »5 Il écrivit de même à Louis Havet le 30 décembre 1906 : «… tout cela m’a profondément découragé et ma désillusion est d’autant plus dure que j’ai plus d’admiration pour le caractère du général Picquart. Est-ce parce que je n’ai que 41 ans, mais on ne peut m’en vouloir d’être entré à 17 ans à l’École polytechnique… »6
Carvallo dut encore attendre deux ans pour être nommé chef d’escadron (1908). Il passa lieutenant-colonel en décembre 1914. En 1916, il commandait l’artillerie de la 59e division. Il fut nommé colonel en juillet 1917 et cité à l’Ordre en juin 1918.
Carvallo fut nommé commandant de l’artillerie de la 23e division en septembre 1920 et général en décembre 1923. Il finit sa carrière militaire comme général de brigade. Il mourut le 28 mars 1929 à Neuilly-sur-Seine.
______________________
2. Moïse Emmanuel Carvallo fut directeur des études de l’École polytechnique de 1909 à 1921. C’est depuis lors que l’École s’appelle « Boîte Carva » dans l’argot des polytechniciens.
3. Dictionnaire de biographie française par M. Prévost et Roman d’Amat, librairie Letouzey et Ané, Paris, 1956, tome VII.
4. Correspondance de Louis Havet, BN Manuscrits, NAFR 24490.
5. Correspondance de Joseph Reinach, BN Manuscrits, NAFR 13571.
6. Correspondance de Louis Havet, op. cit.
FREYCINET Louis Charles (de Saulces de) (1846)
Louis Charles de Saulces de Freycinet naquit le 14 novembre 1828 à Foix (Ariège) dans une vieille famille protestante originaire de la Drôme, de Casimir Frédéric de Saulces de Freycinet, arboriculteur puis directeur des Contributions indirectes et Anne Malet, sans profession. Il entra à l’École polytechnique à 17 ans 36e sur 122, dans la promotion 1846. Sa fiche signalétique établie par l’École indique qu’il avait les cheveux blonds, yeux bleus, visage ovale, qu’il mesurait 1,65 m et qu’il n’avait pas de signes particuliers.
En février 1848, alors qu’il était encore élève à l’X, Freycinet intervint avec quelques camarades dans les échauffourées du boulevard des Capucines et aida à dégager les soldats assiégés dans la caserne de la Pépinière. Il se trouva alors par hasard à l’Hôtel de Ville auprès de Lamartine lors de la constitution du gouvernement de Dupont de l’Eure. Toujours à l’X, il fut ensuite chargé de missions par le gouvernement provisoire à Melun et à Bordeaux7.
Il sortit de l’X 6e en 1848 et choisit le corps des Mines qui l’affecta en service ordinaire à Mont-de-Marsan où il fit l’étude géologique du bassin de l’Adour puis à Chartres en 1854 où il s’intéressa aux questions d’assainissement urbain, enfin à Bordeaux en 1855, qu’il quitta l’année suivante pour devenir chef de l’exploitation des Chemins de Fer du Midi. Il écrit à ce sujet dans ses souvenirs : « Je n’avais pas trente ans et j’apportais dans mes nouvelles fonctions toute l’ardeur qu’on éprouve d’ordinaire à cet âge. Bien que diverses raisons m’aient déterminé plus tard à les abandonner, je n’ai jamais regretté les cinq années que je leur ai consacrées. Il n’est pas pour l’esprit de meilleure école de discipline et de précision. L’obligation banale de faire partir les trains à l’heure et la préoccupation d’éviter les accidents déterminent, du haut en bas de l’échelle, des soins vigilants et une exactitude scrupuleuse. »8
En 1862, il revint au service des Mines qui lui confia des missions variées comme l’étude de l’assainissement industriel en Belgique, en Suisse, en France et à Londres ou le travail des femmes et des enfants dans les manufactures anglaises, étude couronnée par l’Académie des sciences morales. Il fut nommé ingénieur en chef des Mines en 1865 et officier de la Légion d’honneur en août 1870.
En septembre 1870, après la chute de l’Empire, Gambetta nomma Freycinet préfet du Tarn-et-Garonne où il ne resta qu’un mois. Gambetta le nomma alors délégué à la Guerre dans le gouvernement de la Défense nationale à Tours, chargé de la Défense dans les provinces. Il y fit merveille ainsi qu’en atteste une lettre de novembre 1870 de Gambetta à ses collègues restés à Paris : «… J’ai eu la bonne fortune de trouver des collaborateurs à la fois novateurs et prudents. Il serait trop long de vous en donner la brillante liste, mais je ne puis cependant passer sous silence le plus brillant d’entre eux, mon collègue à la Guerre, M. C. de Freycinet dont le dévouement et la capacité se sont trouvés à la hauteur de toutes les difficultés pour les résoudre comme de tous les obstacles pour les vaincre. »9
En janvier 1876, Freycinet fut élu sénateur « gambettiste » de la Seine, siège qu’il conserva jusqu’en 1920. Il fut nommé ministre des Travaux publics en décembre 1877 dans le cabinet Dufaure, auquel succéda bientôt Waddington. Il mit alors en œuvre des programmes de grands travaux pour développer le réseau ferroviaire français (plan Freycinet de juin 1878) ainsi que les ports maritimes et les voies navigables et réforma la législation minière.
Grévy le nomma président du Conseil et ministre des Affaires étrangères en décembre 1879. Il fit voter une amnistie pour les crimes politiques récents mais son cabinet tomba en décembre 1880 sur une question de loi contre les congrégations enseignantes, notamment jésuites, préparée par Jules Ferry. Après l’intermède du « grand ministère » de Gambetta, pendant lequel le corps des Mines lui confia obligeamment une mission sur l’exploitation des chemins de fer en France et à l’étranger, il redevint en janvier 1882 président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. Il tomba en mars 1885 à la suite de sa décision malheureuse de laisser la flotte anglaise combattre seule les Égyptiens révoltés, perdant ainsi au profit des Anglais l’influence que la France s’était créée au fil des siècles au Proche-Orient. Ministre des Affaires étrangères en mars 1885 dans le cabinet Brisson, il redevint président du Conseil en janvier 1886 pour tomber en décembre sur une question de traitement des sous-préfets.
Il fut candidat à la succession de Grévy à la présidence de la République en 1887 mais un autre polytechnicien, Sadi Carnot (X 1857, Ponts et Chaussées) lui fut préféré. Il devint ministre de la Guerre en avril 1888 dans les cabinets Floquet puis Tirard, pour redevenir président du Conseil pour la quatrième fois en mars 1890. Il entreprit alors les premières négociations qui devaient conduire à l’alliance avec la Russie. Il tomba en février 1892 sur la question religieuse pour redevenir ministre de la Guerre dans les cabinets Loubet puis Ribot jusqu’en janvier 1893. Pendant ces cinq années qui ont été, selon le maréchal Foch, un bienfait national10, il réorganisa notamment le Conseil supérieur de la Guerre, l’état-major et les transports de défense ainsi que l’avancement des officiers.
Dès son départ du Cabinet, Freycinet devint président de la Commission de l’armée du Sénat, poste qu’il conserva jusqu’en 1920, soit vingt-sept ans ! À ce titre, il aurait informé Scheurer-Kestner en février 1895 que la condamnation de Dreyfus avait été prononcée sur la base de pièces secrètes et lui aurait déconseillé de s’occuper de l’affaire11.
En novembre 1898, à la retraite depuis bientôt six ans, Freycinet redevint ministre de la Guerre dans le cabinet Dupuy qui succédait à Brisson quelques jours après l’ouverture des débats sur la révision du procès Dreyfus. Soucieux de ne pas faire de vagues, il refusa la demande d’ajournement du procès Picquart jusqu’après l’arrêt de la Cour de cassation et mit divers obstacles au travail de la Chambre criminelle.
Freycinet quitta son Ministère en mai 1899, après s’être fait interpeller par le député Gouzy (X 1852) pour avoir suspendu le cours de Georges Duruy, professeur d’histoire et de littérature à l’X, coupable d’avoir écrit des articles dans Le Figaro intitulés Pour la justice et pour l’armée. Selon le général Mercier, il aurait dit le lendemain de sa démission au général Jamont que le gouvernement savait que l’argent de la campagne en faveur de Dreyfus venait d’un syndicat financé par l’étranger dont l’Angleterre et l’Allemagne. Il confirma ces dires au procès de Rennes au cours duquel il se cantonna à une prudente neutralité. Ce n’est que lors de la deuxième révision, en mars 1904, qu’il désavoua en partie Mercier12.
Surnommé familièrement « la souris blanche », il redevint ministre d’État pendant quatorze mois dans le cabinet de Guerre de Briand en 1915–1916. Il ne se représenta pas en 1920 et mourut le 14 mai 1923 à Paris.
Freycinet a laissé de nombreuses publications dont : Étude géologique sur le bassin de l’Adour (1854), Traité de mécanique rationnelle (1858, 2 vol.), De l’analyse infinitésimale, étude sur la métaphysique du haut calcul (1860), Des pentes économiques en chemin de fer (1861), Emploi des eaux d’égout en agriculture (1869), Principes de l’assainissement des villes et Traité d’assainissement industriel (1870), La guerre en province pendant le siège de Paris (1871), Essais sur la philosophie des sciences, analyse, mécanique (1896), Les planètes téléscopiques (1900), Sur les principes de la mécanique rationnelle (1902), De l’expérience en géométrie (1903), La question d’Égypte (1905), Mes souvenirs jusqu’en 1893 (1911). Il fut élu membre libre de l’Académie des sciences en 1882 et membre de l’Académie française en 1890.
L’École polytechnique commémora solennellement en 1928 le centenaire de la naissance de Freycinet. Sous la présidence du maréchal Foch (X 1871) furent successivement évoqués le polytechnicien, l’ingénieur, l’homme de science, l’académicien et le patriote. Mais pas un mot ne fut dit du Dreyfusard, et pour cause !
______________
7. Dictionnaire de biographie française, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1979, tome xiv.
8. Souvenirs, p. 78–79, cité dans André Thépot, Les ingénieurs des Mines du XIXe siècle, tome i, Eska Paris 1998, p. 386.
9. André Thépot, op. cit. p. 464.
10. Discours du maréchal Foch aux cérémonies du centenaire de Freycinet, X‑Informations, 25 nov. 1928, p. 104.
11. Joseph Reinach, Histoire de l’affaire Dreyfus, II, p. 169, cité par Dutrait-Crozon, p. 51.
12. Minutes du procès de Rennes, I, p. 106, cité par Dutrait-Crozon, p. 102 et 300.
MERCIER Auguste (1852)
Auguste Mercier naquit le 8 décembre 1833 à Arras de François Augustin Mercier, chef d’escadron et Eugénie Vandré, sans profession. Il entra à l’École polytechnique à 19 ans dans la promotion 1852. Sa fiche signalétique établie par l’École indique qu’il avait les cheveux châtains, yeux bruns, visage ovale, qu’il mesurait 1,79 m et qu’il n’avait pas de signes particuliers.
Entré à l’X 4e sur 106, il en sortit second en 1854 et choisit l’artillerie dont il fit l’école d’application.
Il servit au Mexique pendant la guerre de 1863–1867. Il prit part ensuite aux batailles contre les Allemands sous Metz en 1870.
Il fut nommé général de brigade en 1884, directeur des services administratifs à la Guerre en 1888, divisionnaire en 1889 et commandant du XVIIe corps en 189313. Il fut directeur de l’École pyrotechnique de Bourges où il se spécialisa dans les projectiles dont les obus à mitraille.
Mercier fut chargé du portefeuille de la Guerre en décembre 1893 dans le cabinet Casimir-Perier après la démission de Freycinet (X 1846). C’est en accord avec lui que le commandant Sandherr rédigea alors les instructions permettant, en cas de mobilisation, d’interner toutes les personnes suspectes14. Il s’était construit la réputation d’un officier intelligent et réfléchi, qui passait pour républicain – il était catholique et avait épousé une Anglaise protestante, mais n’allait pas à la messe – et ouvert aux idées libérales, ce qui n’était pas fréquent. Il était grand, très maigre, froid, sévère, son visage semblait taillé à la serpe, il gardait toujours ses yeux mi-clos et son sourire, un peu forcé, se contractait en rictus. Il était courtois, peu bavard, très énergique, doué d’une étonnante mémoire15.
Il conserva son poste en mai 1894 dans le cabinet Dupuy, ce qui lui donna le sentiment d’être inamovible : « Il tranchait de tout, sec, hautain, d’une infatuation provocante, infaillible et sûr de son étoile. »16
En août 1894, Mercier fit libérer par anticipation une partie du contingent ce qui lui valut des réactions virulentes de la presse de droite qui l’accusa de couvrir les Juifs et les espions.
C’est alors qu’il fut avisé que la section de statistique avait intercepté ce qui allait devenir le « Bordereau ». Il ordonna aussitôt des recherches rapides pour trouver le traître et redorer ainsi son blason auprès de la droite. Dès le 7 octobre, convaincu de tenir le coupable, il en informa le président de la République Casimir-Perier et le président du Conseil Charles Dupuy en leur montrant le Bordereau et les modèles d’écriture de Dreyfus.
Une expertise légale ayant été suggérée par le commandant du Paty de Clam, Mercier fit appel à Gobert, expert à la Banque de France, sur la recommandation du ministre de la Justice Guérin. Mais le rapport de Gobert ne fut pas concluant et Mercier fit alors appel à Alphonse Bertillon qui conclut positivement. Il n’en fallut pas plus à Mercier pour faire convoquer Dreyfus au Ministère et le faire interroger par du Paty de Clam qui fit procéder aussitôt à son arrestation.
Le 1er novembre 1894, à la suite d’indiscrétions parues dans la presse, Mercier informa de la situation le Conseil des ministres qui décida des poursuites à l’unanimité. Alors que l’instruction commençait à peine et que les experts en écriture étaient divisés, Mercier n’hésita pas à affirmer sa certitude de la culpabilité de Dreyfus dans un article du Figaro17 dont il contesta la véracité en 1904 devant la Cour de cassation. Mais il campa sur ses certitudes toute sa vie.
Avec Dupuy, Mercier fut de la « nuit historique » du 12 décembre 1894 à l’Élysée, pendant laquelle se joua, prétendit-il, le sort de la guerre entre la France et l’Allemagne. Il fut à l’origine de la communication du dossier secret au Conseil de guerre. Le 25 décembre 1894, dès Dreyfus condamné par le Conseil de guerre, il déposa à la Chambre un projet de loi rétablissant la peine de mort pour crime de trahison.
En février 1895, après l’élection de Félix Faure en remplacement de Casimir-Perier à la présidence de la République, où il était candidat et avait recueilli trois voix seulement, Mercier fut remplacé à la Guerre par Émile Zurlinden (X 1856), non sans avoir eu le temps de « mettre de l’ordre » dans le dossier Dreyfus et notamment de détruire le commentaire écrit par du Paty et de préparer un projet de loi qui rétablissait les îles du Salut comme lieu de déportation. Il devint alors commandant du 4e corps d’armée pour passer dans la réserve en 1898.
Dans J’accuse, publié dans l’Aurore du 13 janvier 1898, Émile Zola, qui n’avait pas compris l’importance de son rôle, l’accusa seulement « de s’être rendu complice, tout au moins par faiblesse d’esprit, d’une des plus grandes iniquités du siècle. » Cité au procès Zola en février, « hautain, flegmatique, précis, dédaigneusement retranché dans la conscience de son infaillibilité, il déclara que Dreyfus était un traître qui avait été justement et légalement condamné »18 et refusa de répondre sur l’existence de pièces secrètes.
Mercier et ses successeurs à la Guerre, Zurlinden, Cavaignac, Billot, Chanoine, furent auditionnés en novembre 1898 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans le cadre de la procédure de révision. Tous cinq affirmèrent la culpabilité de Dreyfus. Pour faire bonne mesure, Mercier déclara que la Chambre criminelle était achetée par le Syndicat. Il fit partie des 28 généraux en retraite qui participèrent à la souscription en faveur de la veuve du commandant Henry en décembre 1898.
En juin 1899, après l’arrêt de la Cour de cassation, Mercier fut près d’être mis en accusation à son tour par la Chambre (228 voix contre 277) mais il ne désarma pas : « Je ne suis pas un accusé, je reste un accusateur… »19 Installé à Rennes, il se présenta comme chef de file des antidreyfusards, annonçant dans la presse de droite des révélations décisives à venir, comme l’existence d’un original du bordereau annoté par le Kaiser lui-même. En fait, sa déposition devant le Conseil de guerre, qui dura quatre heures, n’apporta pas d’élément nouveau et sa conclusion fut sans appel : « Ma conviction depuis 1894 n’a pas subi la plus légère atteinte ; elle s’est approfondie par une étude plus complète de la cause ; elle s’est fortifiée enfin par l’inanité des résultats obtenus pour démontrer l’innocence du condamné, malgré le chiffre énorme des millions follement dépensés ! »20 Confronté le surlendemain 14 août avec l’ancien président de la République Casimir-Perier, il soutint la thèse de l’implication personnelle du Kaiser et de l’imminence d’une guerre avec l’Allemagne en janvier 1895.
Lors des débats sur le projet de loi d’amnistie en novembre 1899, Clemenceau et Jaurès demandèrent à nouveau la mise en accusation de Mercier, « le premier des criminels ». Mercier, qui venait d’être élu sénateur nationaliste de Loire-Inférieure en janvier 1900, siège qu’il conserva jusqu’en 1920, répéta alors qu’il avait agi en 1894 avec la conviction intime et profonde qu’il rendait service à son pays21.
En mars 1904, devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation, Mercier défendit encore « l’irréfutable » démonstration de Bertillon. Sommé en juillet 1906 par La Libre Parole de dévoiler enfin ses preuves à la veille du rendu de l’arrêt de la Cour, il se borna à réitérer sa conviction de la culpabilité de Dreyfus et à rendre hommage «… à tous ceux qui, soit comme juges, soit comme témoins civils ou militaires, avaient apporté de leurs mains loyales et courageuses une pierre à l’édifice, désormais indestructible, de la culpabilité d’un officier traître à sa patrie. »22 Le 13 juillet 1906, au Sénat, il vota contre la réintégration de Dreyfus et de Picquart et accusa la Cour de cassation d’avoir suivi une procédure irrégulière, « sans publicité des dépositions, sans publicité des débats, sans confrontation des témoins. »23 L’Action française ouvrit alors une souscription pour lui offrir une médaille d’or en souvenir de cette séance dans laquelle il avait « tenu tête aux parlementaires affolés ». Cette médaille lui fut remise le 29 juin 1907 dans la salle Wagram devant 6 000 personnes24.
Mercier mourut à Paris le 3 mars 1921. Jusqu’à son dernier souffle, droit dans ses bottes, il ne cessa jamais de clamer la culpabilité de Dreyfus.
___________________
13. Larousse du XXe siècle, Larousse, tome IV.
14. L’Affaire, Jean-Denis Bredin, Fayard-Julliard, 1993, p. 66.
15. Bredin, op. cit., p. 86–87.
16. Joseph Reinach, Histoire de l’affaire Dreyfus, Revue blanche 1901, Fasquelle 1929, t. I, p. 1 sq, cité par Bredin, op. cit., p. 86.
17. Interview dans Le Figaro du 28 novembre 1894, citée par Bredin, op. cit., p. 116.
18. Procès Zola, I, p. 167–172, cité par Bredin, op. cit., p. 357.
19. Le Temps, 7 juin 1899, cité par Dutrait-Crozon, p. 240.
20. Déposition du général Mercier le 12 août 1899, citée par Bredin, op. cit., p. 551.
21. Cité par Bredin, op. cit., p. 594.
22. Lettre du 6 juillet 1906 au premier président de la Cour, l’Éclair du 7 juillet, Dutrait-Crozon, p. 516.
23. Dutrait-Crozon, p. 557.
24. Dutrait-Crozon, p. 563.
PRÉVOST Eugène Marcel (1882)
Eugène Marcel Prévost naquit le 1er mai 1862 à Paris dans une famille bourgeoise de Eugène François Prévost, sous-directeur des contributions directes et Eugénie Élisabeth Boudin, sans profession. Après des études au petit séminaire d’Orléans puis à Châtellerault et à Bordeaux, il fit des études humanistes chez les Jésuites à Paris, ponctuées de tous les premiers prix, en lettres comme en sciences25 , il entra à l’École polytechnique à 20 ans dans la promotion 1882, soit quatre ans après Dreyfus. Sa fiche signalétique établie par l’École indique qu’il avait les cheveux châtains, yeux bleu clair, visage ovale, front bombé, et qu’il mesurait 1,67 m.
Entré à l’X 97e sur 247, il en sortit 20e en 1884 et choisit les manufactures de l’État (Tabacs) puis travailla un moment au ministère des Finances. Il démissionna de son poste en 1890 pour se consacrer à l’écriture.
Il publia dès 1887 Le Scorpion, qui fut remarqué par Hérédia et fut publié en feuilleton dans les journaux. Suivirent une trentaine de romans à succès, aujourd’hui oubliés depuis longtemps, toujours basés sur l’analyse du cœur humain, surtout féminin : Chonchette (1888), Mlle Jaufre (1889), Cousine Lara (1890), La confession d’un amant (1891), l’Automne d’une femme (1893), etc.
Les Demi-Vierges, paru en 1894, suscitèrent un succès de curiosité et de scandale à la fois. Pour compenser, il créa le personnage de Françoise, femme sage et heureuse (Lettres à Françoise, 4 vol.). La même année, sa réputation de spécialiste des choses du cœur fit qu’il fut nommé membre d’une commission de révision du Code civil, chapitre mariage.
L’un des premiers dreyfusards, Prévost participa avec Émile Zola, Louis Sarrut et Louis Leblois au dîner organisé le 13 novembre 1897 par Scheurer-Kestner, au cours duquel ce dernier décida de faire part de sa conviction au public26.
Prévost fut présent à Rennes dès le premier jour. Il fut le 8 novembre 1899 du premier « Dîner des Trois Marches » qui réunit tous les « combattants » du procès de Rennes et se tinrent régulièrement jusqu’en 1912 à l’initiative d’Edmond Gast et de l’éditeur Pierre-Victor Stock27.
Prévost fut élu en 1909 à l’Académie française au fauteuil de Victorien Sardou, battant Édouard Drumont. Il poursuivit sa brillante et prolifique carrière littéraire jusqu’à la guerre avec un roman par an comme Féminités (1912), Les Don Juanes (1922), La Mort des Ormeaux (1937), etc.
Prévost reçut la Croix de guerre 1914–1918. Il fut nommé en 1922 directeur de la Revue de France, poste qu’il conserva jusqu’en 1940. Il fut nommé en 1935 grand-croix de la Légion d’honneur et en 1939 président de la Société amicale de secours des anciens élèves de l’École polytechnique. Il présida également la Société des gens de lettres et la section littéraire du Conseil supérieur de radiodiffusion. À ce titre, il intervint le 31 mars 1939 au Théâtre des Ambassadeurs à la présentation de la télévision française nouvellement née, en pressentant l’immense développement à venir : «… cette suprême découverte nous annexe l’univers. Le sens du mot voyage est changé : c’est le monde extérieur qui se déplace, vient à nous, s’arrête devant nous. Un écolier – quand la télévision scolaire sera définitivement accomplie – aura fait plusieurs fois le tour du monde… à l’âge de dix ans… »28
Il mourut le 8 avril 1941.
______________
25. François Bédier, Marcel Prévost, de Polytechnique aux Demi-Vierges, La Jaune et la Rouge, mai 1995, p. 16.
26. Alfred Dreyfus, Carnets 1899–1907, Calmann-Lévy, 1998, p. 402.
27. Jean-Denis Bredin, L’affaire, p. 541 note.
28. Discours aux Ambassadeurs, Revue de France, 1er mai 1939.