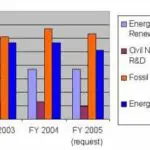Emploi et nouvelles technologies

1. Les conséquences de l’automatisation
1. Les conséquences de l’automatisation
Depuis le début de l’industrialisation, les entreprises n’ont cessé de rechercher et d’adapter les nouvelles technologies et de mettre en œuvre de nouvelles techniques. Les phases successives de la révolution industrielle se sont toutes traduites par le remplacement de la force humaine et de l’habileté de l’homme par celles des machines. Mais l’informatisation a accéléré cette évolution. L’augmentation de la puissance et de la vitesse de calcul des processeurs, leur miniaturisation conduisent à un accroissement de « l’intelligence » des machines et étend leur capacité à remplacer l’être humain.
Les progrès de productivité sont considérables, ce qui réduit rapidement la demande de travail non qualifié ou peu qualifié. Mais à l’inverse, la conception des outils, le contrôle et le suivi des processus de production, la logistique et la conduite des projets exigent une compétence et surtout une fiabilité telles que les techniciens capables de les assurer sont très demandés et reçoivent des rémunérations élevées. Il en résulte un élargissement de l’éventail des rémunérations et la coexistence d’un chômage élevé pour les uns et d’une suractivité, bien rémunérée, pour les autres.
Dans l’industrie manufacturière, les nouvelles technologies réduisent les effectifs d’ouvriers peu qualifiés. Ce phénomène n’est bien entendu pas nouveau, mais il atteint des proportions nouvelles. On parle plus souvent de la délocalisation des emplois que de l’automatisation. Mais en fait le risque de délocalisation vers des pays à bas salaires ne fait qu’amplifier un phénomène interne aux économies industrielles. Il est vrai que les statistiques surestiment la baisse des emplois dans l’industrie manufacturière : il y a simultanément création d’emplois tertiaires (de conception, d’informatique, de marketing, etc.) inséparables de l’activité de production, mais sous-traités ou externalisés. Néanmoins la baisse du nombre d’emplois non qualifiés se fait à un rythme trop rapide pour que d’autres possibilités d’emplois s’y substituent.
En outre, l’automatisation touche aussi depuis les années 80 le secteur des services de masse : banques, assurances, organismes de sécurité sociale, etc. Les personnels administratifs de ces secteurs, dont la logique de production peut être assimilée à celle des ouvriers de l’industrie manufacturière (faible qualification, gestes automatiques qui peuvent maintenant être réalisés par des ordinateurs, fonctionnement taylorien, ateliers collectifs, etc.) se trouvent dans la même situation. Les emplois disparaissent, au fur et à mesure que les progrès techniques permettent aux machines de s’y substituer. Les banques ou les sociétés d’assurances créent d’autres types d’emploi ; mais des emplois commerciaux qui exigent des compétences que les employés administratifs n’ont guère.
La disparition des emplois peu qualifiés dans l’industrie manufacturière et dans les services de masse devrait être compensée en partie par la création d’emplois dans les services aux personnes. Les sociétés européennes ont aujourd’hui besoin de services de soins, d’accueil, de protection et de sécurité, de garde d’enfants, d’accompagnement des personnes âgées, de préservation de l’environnement, de loisirs et de culture. À ces besoins nouveaux des producteurs de services peuvent répondre, à condition que la demande soit solvable. Où trouver l’argent ? Dans les gains de productivité réalisés dans l’industrie et les grands services qui lui sont liés. Mais les circuits financiers qui permettraient que les gains de productivité générés par l’automatisation aillent vers les producteurs de services aux personnes n’existent pas ou pas suffisamment. Si ces circuits existaient, les pertes d’emplois non qualifiés pourraient être compensées par les créations d’emplois de services.
Ces services peuvent être soit marchands, c’est-à-dire payés par les consommateurs, soit non marchands, c’est-à-dire mis gratuitement à la disposition des consommateurs, donc financés par l’impôt, soit encore mixtes. Dans le premier cas, il faudrait que les consommateurs soient prêts à payer le vrai prix ; mais, habitués à l’État-providence, les citoyens européens ne l’acceptent pas ou ne le peuvent pas. Dans le second cas, il faudrait accroître le prélèvement fiscal, ce que les citoyens n’acceptent plus. Faute de services suffisants, les problèmes sociaux s’aggravent ; faute d’emplois dans ce domaine, le chômage ne se réduit pas.
La disparition de nombreux emplois non qualifiés s’accompagne de la création de nouvelles qualifications et compétences. L’éducation et la formation deviennent ainsi une priorité. La formation initiale ne suffit plus. Parce que la technologie et les marchés ne cessent d’évoluer, la formation continue est nécessaire à chacun, tout au long de sa vie, pour préserver son employabilité.
L’employabilité est la capacité pour un travailleur de préserver, de trouver ou de retrouver sa place sur le marché du travail. Or, l’évolution technologique et économique contraint à l’adaptation permanente.
Cette priorité de l’employabilité concerne l’individu lui-même (qui sait qu’il changera plusieurs fois de technique, de fonction, de métier, d’employeur dans sa vie et qu’il lui faut préparer son avenir par la formation permanente), l’entreprise (qui a le devoir de préserver l’employabilité de ses travailleurs en leur donnant la possibilité de se former en permanence), l’État (qui est responsable de la formation initiale et de l’appui à ceux qui n’ont pu se maintenir à flot et se reconvertir).
2. La révolution des communications
La plus importante des conséquences du développement des nouvelles technologies de l’information dans les entreprises est le bouleversement qu’elles ont entraîné dans la communication au sein de l’entreprise et avec son environnement.
Les méthodes de management en ont été et en seront encore durablement et définitivement affectées. Comme la communication entre les acteurs au sein de l’entreprise n’est plus prisonnière du papier, mais circule de façon très libre, non ou peu contrôlée par les échelons hiérarchiques, à travers les réseaux informatiques et le courrier électronique, la hiérarchie perd un pouvoir qu’elle détenait pour l’essentiel de sa capacité à retenir et à modifier l’information montante ou descendante. Chaque salarié de l’entreprise peut communiquer avec tous les autres et il se crée des relations de travail horizontales et transversales. Comme les tâches de pure exécution ne nécessitant aucune initiative sont maintenant automatisées, les travailleurs sont appelés à être réactifs, à être capables de répondre eux-mêmes à l’imprévu et à décider eux-mêmes plutôt qu’à réaliser des gestes automatiques. Pour cela, ils ont besoin de disposer d’informations multiples que leur fournira le réseau auquel ils sont liés : en quelque sorte, le réseau de communication se substitue à la hiérarchie, les dirigeants agissant moins par voie de directives et d’instructions que par des projets et des objectifs. Les relations au sein de l’entreprise prennent un caractère contractuel : chacun s’engage à l’égard de ses partenaires sur des résultats, une qualité, des délais.
Il est plus difficile aujourd’hui de tracer les contours d’une entreprise. En effet les relations contractuelles qui se créent au sein de l’entreprise ne diffèrent guère de celles qui existent entre deux entreprises. À la limite, peu importe pour le salarié d’un bureau ou d’un atelier que son correspondant appartienne ou non à la même firme : de toute façon, il est en contrat avec lui. C’est ainsi que se sont développées toutes les formes d’externalisation qui font de l’entreprise un être économique et juridique aux contours flous. L’entreprise ne se comporte plus comme une entité close, avec ses dirigeants et ses salariés, enfermée dans ses murs, mais comme un élément parmi d’autres au sein d’une chaîne complexe dont les maillons sont reliés entre eux par des contrats. Elle concentre sa propre activité sur son métier central. Elle externalise ce qui n’est pas au cœur de sa production. C’est la course à l’externalisation sous toutes ses formes (outsourcing, facility management, maintenance sous-traitée, recours croissant au travail intérimaire, self-employment).
Une conséquence importante du développement des systèmes de communication modernes est la généralisation du « juste à temps » dans l’ensemble des activités de production et de transaction. Une partie importante des travailleurs de l’industrie et des services est concernée par les conséquences de ces changements de rythme dans les modes de production et d’échange. L’accent mis sur les délais conduit à des tensions au sein des équipes de production dès qu’il y a un incident ou une urgence. Il en résulte une pénibilité d’un type nouveau, particulièrement sensible chez les managers. Le juste à temps n’est possible que parce qu’il existe des moyens de communication qui l’ont permis. Les entreprises industrielles ont commencé à travailler en flux tendus – c’est-à-dire sans stocks – dès lors que les transactions entre fournisseur et utilisateur pouvaient être traitées instantanément. L’extension du juste à temps à toutes les transactions au sein et hors de l’entreprise a été rendue possible par les messageries électroniques et les téléphones cellulaires.
L’une des premières qualités de l’entreprise est aujourd’hui la réactivité, c’est-à-dire la capacité à répondre sans délai à des événements touchant aussi bien les marchés que les techniques de production. Cette réactivité impose des modes de fonctionnement souples et décentralisés. Elle implique aussi la flexibilité : celle-ci peut être soit une flexibilité interne (temps de travail, mobilité professionnelle, polyvalence, passerelles entre les qualifications, mobilité géographique), soit une flexibilité externe (contrats de travail temporaires, facilités de licenciements et plus généralement souplesse des contrats de travail), soit encore cette forme intermédiaire de flexibilité que constituent l’externalisation des activités et la sous-traitance. Or, cette flexibilité externe est source de précarité et donc de chômage, d’exclusion, de malaise social : il faut que les entreprises soient mises en situation de préférer systématiquement la flexibilité interne. Il faut que des politiques d’employabilité fassent obstacles à la précarisation qu’entraîne la flexibilité externe. Il faut que la législation mette de l’ordre dans les processus d’externalisation. Si la flexibilité et la précarité deviennent synonymes, les sociétés européennes n’accepteront plus les politiques de flexibilité pourtant nécessaires conduites par les entreprises.
3. Des inégalités nouvelles
Dans son ouvrage Work of nations, le professeur Robert Reich, ancien ministre américain du Travail, distingue, au sein de l’économie américaine, quatre catégories de travailleurs. Il y a d’abord ce qu’il appelle les « manipulateurs de symboles ». Le produit de leur travail, ce sont des idées ou des informations. Leurs outils sont les nouveaux outils technologiques et notamment Internet. Puis viennent les enseignants, les personnels de santé, etc., tous ceux qui jouent un rôle de service public. Troisième catégorie : les services aux particuliers, qui ne sont pas des rouages dans des machines à produire du bien ou du service mais sont en relation directe avec le consommateur. Enfin le quatrième quart est constitué des travailleurs « routiniers », ouvriers d’usines ou employés faisant un travail répétitif.
Les manipulateurs de symboles ont tout à gagner à la mondialisation. Les derniers ont tout à perdre : ils peuvent être facilement remplacés par des ouvriers ou des employés de pays à bas salaires. Les deux autres catégories se développeront plus ou moins suivant les décisions prises par les pouvoirs publics et la capacité d’adaptation de l’économie. Les services aux personnes se développeront si des mesures sont prises dans ce sens. Quant aux fonctions de la seconde catégorie – enseignement, santé, etc. – elles sont en crise dans tous les pays européens. Leur avenir dépend du choix qui est fait en ce qui concerne leur financement.
L’effet de la mondialisation, selon cette analyse, est donc clair. Les uns tirent avantage de la mondialisation. Dans cette catégorie des « manipulateurs de symboles », la qualité et la fiabilité de la prestation n’ont pas de prix et les salaires peuvent atteindre des niveaux très élevés. Les routiniers ont tout à perdre dans les pays industriels.
L’internationalisation et l’intensification de la concurrence au plan mondial sont une conséquence directe de l’instantanéité et du faible coût de la communication. Dès lors que l’on peut donner des ordres financiers instantanément à des dizaines de milliers de kilomètres de distance, les transactions, qu’elles soient financières, monétaires, commerciales ou d’échanges de données, changent de nature et font de la planète entière un marché unique.
Les grands groupes internationaux dépendent d’investisseurs dont les principales préoccupations sont financières et non pas industrielles. Les grandes décisions d’ouverture ou de fermeture de sites de production, de spécialisation des sites, de développement ou de réduction sont prises loin des sites de production eux-mêmes, par des décideurs qui peuvent n’avoir aucune information autre que financière sur les conséquences de ces décisions. L’éloignement fait qu’ils s’en préoccupent peu. Sur place en revanche, la gestion de l’usine ou des bureaux, le management des ressources humaines, la gestion de l’emploi, la formation, les rémunérations sont réalisés de façon beaucoup plus décentralisée que dans le passé. Le responsable local a tous les pouvoirs…, sauf que des décideurs internationaux ont un pouvoir de vie et de mort sur le site. Les travailleurs, mais aussi tout leur environnement administratif, politique, social, économique se sentent trahis lorsque des décisions de fermeture sont prises, alors que le management du site jouait le jeu du développement local. Les autorités publiques sont trop souvent impuissantes devant de telles décisions. C’est un des paradoxes de la globalisation que cette coexistence de deux pouvoirs économiques sur les hommes : un pouvoir lointain et aveugle et un pouvoir proche mais susceptible d’être brutalement remis en cause.
Mondialisation et nouvelles technologies de l’information : ce sont deux phénomènes inséparables qui ont conduit et conduiront plus encore dans l’avenir les entreprises européennes à modifier profondément leur organisation et leur mode de fonctionnement. L’apparition et le développement des nouvelles technologies ont rendu possible l’actuelle mondialisation de l’économie. Dès lors que les communications entre les centres de décision sont instantanées et peu coûteuses, les décisions d’investissement ne sont plus limitées à un pays ou à une région. Dès lors que la société de l’information remplace la société de production industrielle de masse, c’est-à-dire où ce qui fait la richesse d’une entreprise ou d’une société est sa capacité à gérer, transformer, partager, diffuser des données, la localisation des entreprises et des productions perd une grande partie de son importance.
La concurrence acharnée que se livrent les entreprises au plan international a pour effet de leur interdire de « prendre leur temps », c’est-à-dire de régler en douceur l’adaptation progressive de leurs produits et de leurs processus de production et de commercialisation. L’adaptation est brutale, parce que dans la compétition internationale, celui qui prend du retard est vite distancé. Les niveaux élevés de chômage et les crises sociales qui frappent les pays d’Europe occidentale s’expliquent par l’impossibilité dans laquelle ils sont d’assurer en douceur les adaptations aux nouvelles technologies. Un pays qui chercherait à s’abriter derrière ses frontières pour prendre le temps d’adapter ses structures économiques et sociales serait vite rattrapé par la pression de l’économie mondiale.