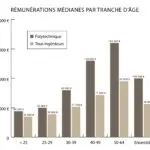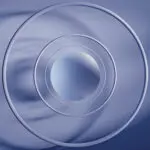Management et cultures nationales, vers un nouveau paradigme interculturel

Philippe d’Iribarne (X55), Jean-Pierre Segal, Sylvie Chevrier, Alain Henry (X73) et Geneviève Tréguer-Felten viennent de publier aux Presses des mines l’ouvrage intitulé : Cultures et management international, un nouveau paradigme. Cet ouvrage, qui mérite plus qu’une simple recension, met en perspective les aspects du management interculturel pour rendre plus fructueuses les négociations internationales.
Cher lecteur de La Jaune et la Rouge – tu permettras, j’espère, l’usage de la deuxième et de la première personne, s’agissant d’un ouvrage qui interpelle chacun de façon très directe ; précipite-toi pour te procurer ce livre ! Quelle que soit ton expérience avec l’étranger, interactions de touriste avec une bureaucratie, négociations avec des entreprises non françaises, animation de groupes de travail internationaux, fusions ou acquisitions, le livre, proposé par plusieurs auteurs qui ont travaillé en équipe pendant des années et fréquenté les territoires les plus divers, te sera utile : il va éveiller chez toi des souvenirs, éclairer des incompréhensions, préciser ta « francité » en partie inconsciente – et, si tu fais face à des perspectives de partenariats internationaux, t’aider à les mener au mieux.
Un ouvrage totalisant
Cultures et management international est un texte ambitieux, qui embrasse tous les aspects du management interculturel. Au premier abord, l’exposé paraît un peu sinueux, avec de nombreux allers-retours entre théorie et pratique, ainsi qu’entre pays localisés un peu partout sur la planète. Mais plus on avance, plus cette complexité paraît naturelle. On découvre vite que les auteurs brassent des données en quantité et qu’ils les mettent en perspective selon plusieurs angles. En fait l’ouvrage est multidimensionnel.
“L’ouvrage est multidimensionnel.”
La première manière de le parcourir est de se mouvoir dans un tableau à double entrée : en lignes, des thèmes structurants du management comme le leadership, les processus de décision ou le dialogue social ; en colonnes, des pays. Naturellement, toutes les cases ne sont pas remplies. Les colonnes les plus pleines sont sans surprise la française et l’américaine, mais l’africaine est dense aussi, et de nombreuses cases asiatiques sont bien garnies. Concernant les lignes, une place particulière revient au management par objectifs (MBO), tant les tentatives des investisseurs et des bailleurs de fonds pour généraliser cet outil américain à tous les pays révèlent les difficultés soulevées par les écarts culturels. Chaque case est une étude de cas, échecs – souvent – ou réussites.
Dans un second temps les auteurs survolent le tableau en deux colonnes, pour en déduire une vision théorique des cultures nationales et de la façon dont elles s’accommodent des outils de management disponibles ou, au contraire, en entravent ou biaisent la mise en œuvre. Cher lecteur, la formation que tu as reçue garantit que les espaces complexes ne t’effrayent point et tu suivras sans peine les auteurs dans une quatrième dimension : faisant fond tant sur la théorie des cultures que sur l’expérience accumulée dans les cases, ils abordent la conception et l’exécution de démarches de changement adaptées. L’ouvrage pénètre comme avec une vrille la matière complexe qu’il étudie et offre pour finir des propositions concrètes, inspirées par les cas étudiés.
Lignes et colonnes
Dans un premier temps les auteurs explorent six aspects du management (des « lignes » du tableau, donc). Sans résumer toutes les thèses correspondantes, quelques coups de projecteur peuvent être utiles. Mais auparavant une observation sur les cultures nationales (les « colonnes ») est indispensable. On pourrait penser que le niveau national n’est pas forcément le plus pertinent. Cependant, comme tu sais, cher lecteur, si tu as pratiqué les livres de Philippe d’Iribarne, il y a une telle homogénéité dans les problèmes culturels rencontrés dans les entreprises les plus diverses du même pays, et une telle permanence des régularités nationales dans la durée, que ce niveau s’impose comme primordial.
S’agissant du leadership, premier exemple, le manager français est présumé encourager son subordonné à bien faire son métier, dont celui-ci maîtrise les savoir-faire, accorder une certaine confiance et donc ne pas suivre le travail de trop près, et diriger au nom de la raison, sans arbitraire aucun. Le chef se légitime par sa compétence technique, qu’attestent les diplômes. À l’opposé, le manager américain doit inciter chacun à donner le meilleur de lui-même dans un cadre formalisé, il peut et même doit suivre continûment le travail de ses collaborateurs et il incarne des valeurs collectives qui font de lui le garant de l’unité des équipes. Il se légitime par son charisme bien plus que par sa maîtrise technique.
“En France le compromis n’est pas valorisé.”
Deuxième illustration, l’opposition entre modèles de prise de décision. En France le compromis n’est pas valorisé. Un choix négocié apparaît comme une cote mal taillée entre deux points de vue rationnels, le compromis est jugé « mou » par nature. Seule l’argumentation structurée emporte l’adhésion – d’où l’importance de l’expertise du leader – et par conséquent dans la discussion il s’agit de convaincre. Si le résultat déplaît à l’une des parties, elle ne se sentira pas tenue à une application rigoureuse.
Aux Pays-Bas et en Europe du Nord, en revanche, le rôle du manager est de faire émerger le compromis qui est hautement valorisé et toujours respecté, car il préserve l’unité du groupe, valeur essentielle. En Afrique de l’Ouest la difficulté est encore ailleurs. Le problème est d’éviter des décisions suspectes de favoritisme à l’égard d’un subordonné. Il importe de créer un contexte procédural qui garantisse que, si une décision défavorise quelqu’un, c’est parce qu’elle ne pouvait pas être différente et non parce que le décideur a voulu nuire.
Prendre de la hauteur théorique
Les exemples qui précèdent sont parlants. Peut-être, ami lecteur français (si tu l’es), te remémoreras-tu à leur lecture des souvenirs personnels. Pour qui – je parle d’expérience (bruxelloise) – a animé des groupes multiculturels, inventer un style qui ne soit pas sa manière instinctive est une tâche délicate : je me rappelle avoir tenté consciemment de me « nord-européiser » et à la lecture de l’ouvrage j’ai compris que pour autant je traquais encore, peut-être trop, les contradictions dans les consensus.
Bref, le chemin de crête est toujours un équilibre précaire et l’erreur arrive vite. C’est précisément des doutes ou des déconvenues des acteurs de terrain, qui bricolent à tâtons des solutions, que partent les auteurs pour échafauder leur théorie des cultures nationales, qui éclaire les exemples qui précèdent. Leur thèse centrale, simple et riche de conséquences, est que dans chacune existe une inquiétude structurante, presque une angoisse du chaos, que la « bonne » façon de faire entend conjurer.
“En France, on « rend service », mais on n’est pas « au service » de quelqu’un.”
En France la crainte centrale est celle du rapport servile : il n’est pas question de s’abaisser pour obtenir une faveur. On « rend service », mais on n’est pas « au service » de quelqu’un. Si la notion de métier, et les savoir-faire qui vont avec, sont aussi importants, c’est parce que précisément ils protègent de la servilité : c’est une éthique professionnelle et non le supérieur qui dictent les choix. A contrario, les contrôles trop étroits sont très mal acceptés.
Aux États-Unis ce qui est redouté est de perdre la maîtrise de son destin. La référence implicite y est la relation contractuelle entre deux partenaires : le salarié reste une sorte de propriétaire (de sa force de travail), comme à l’époque où il n’y avait pas de grande structure hiérarchique organisée ; en quelque sorte, il offre son travail sur un marché, selon des dispositions formalisées par écrit. Typiquement, une personne interrogée par les chercheurs décrit sa vision de la relation avec son supérieur par la formule : « Dites-moi ce que vous voulez et je vous le fournirai. » Les procédures formalisées et les contrôles sont donc bien acceptés.
En Afrique occidentale, on redoute l’avidité et l’intention de nuire des autres : soit on a affaire à un ami, à qui on est lié au-delà de la simple coexistence professionnelle, et la confiance va de soi ; soit on peut légitimement craindre d’être la cible de mesures hostiles, et elle est impossible. Chacun, en dehors des solidarités avec les proches, est présumé mû par ses intérêts et tout acte est suspect de porter des intentions cachées. On attend des outils et procédures qu’ils protègent des velléités de nuire et il y a donc avantage à ce que celles-ci soient précises.
Mieux (se) comprendre
Déjà il faut passer à la quatrième dimension : comment agir mieux dans un contexte de choc culturel, où inévitablement chacun interprète les processus non pas en fonction des références de celui qui les a créés et veut les mettre en œuvre, mais en fonction de ses propres références ? Les auteurs répondent : dans un premier temps, en évitant les incompréhensions. Et celles-ci sont possibles dans la communication la plus élémentaire, donc la plus inconsciente. Le premier exemple est particulièrement saisissant : dans les mots de la langue.
Quelle langue ? Lecteur de La Jaune et la Rouge, si tu n’es pas anglo-saxon de naissance, sans doute t’exprimes-tu de façon fluide en globish, ce sabir d’inspiration anglaise employé dans les grandes entreprises et les organisations internationales, en le truffant de quelques gallicismes et avec un petit accent qui, paraît-il, contribue à notre pouvoir de séduction aux États-Unis. Il est moins probable, mais pas impossible naturellement, que tu maîtrises un anglais idiomatique. Eh bien, expliquent les auteurs, la communication en globish, c’est le malentendu. D’ailleurs on apprendra dans l’ouvrage que, en globish académique, ce sabir s’appelle plutôt ELF (English as a lingua franca).
“Des notions centrales du management sont différemment comprises dans deux pays.”
La première raison est simple : le vocabulaire commun aux participants d’une réunion est assez pauvre, donc les nuances passent mal. A contrario, quiconque n’a qu’un bon niveau en globish, même s’il dispose d’un socle solide de « vrai » anglais – et je parle à nouveau d’expérience –, est gagné par la démoralisation face à un Britannique ou un Américain qui ne gaspille aucune énergie à produire subtilités et jeux de mots dans le débat. La seconde raison est plus indirecte et relève de la notion de faux ami. Des notions centrales du management sont différemment comprises dans deux pays, à la fois parce que les significations ne coïncident pas parfaitement et parce qu’elles sont chargées de valeurs différentes : typiquement « contrôle » (perçu comme tatillon et dévalorisé en français) et « control » (une maîtrise rassurante en anglais).
Tout aussi troublants sont les malentendus qui portent sur la façon de se présenter soi-même ou de présenter son entreprise : la communication naturelle de l’un est perçue comme arrogante par l’autre, l’expression factuelle de l’un est violemment agressive pour l’autre.
Que faire et comment le faire ?
Naviguer dans cet océan d’incompréhensions est difficile mais, les cas de succès cités par les auteurs le montrent, n’est pas impossible pour autant. Il convient d’abord de faire une différence entre deux configurations. Soit deux cultures – ou un très petit nombre – sont en présence, soit on s’efforce de travailler dans un contexte très multinational.
Dans le second cas, les auteurs appellent à modérer l’ambition. Plutôt que d’aspirer à un apprentissage mutuel et à rendre chacun « polyglotte » culturellement, mieux vaut opter pour une structure décentralisée. Un projet multinational pourra avantageusement être découpé en lots et chacun de ceux-ci traité au niveau national, le travail multiculturel se limitant alors à l’assemblage des lots. Moins d’énergie sera consommée à aplanir les différends.
Dans le premier cas, on peut prendre les problèmes à bras-le-corps : ainsi, l’incompréhension entre ceux qui pratiquent habituellement la décision consensuelle et ceux qui lui préfèrent un processus rationnel, ou bien, s’agissant de délégation, entre ceux qui souhaitent une définition très informelle des fonctions des subordonnés et ceux qui sont habitués à un détail extrême. Également, il faut souvent concilier des cultures où prédomine soit une éthique de la fidélité, soit une éthique de rationalité présumée garantir contre les passions. C’est clairement la seconde qui imprègne les outils dominants du management global.
“La méthode proposée par l’ouvrage est concrète et praticable.”
Une démarche d’apprentissage, dans la durée, est suggérée par les auteurs dans une situation à deux cultures : rendre les acteurs conscients de leurs présupposés, les aider à comprendre comment les procédures sont réinterprétées dans les cultures différentes de celle qui les a conçues, mettre en lumière les bonnes pratiques nationales. La chose requiert tant d’effort sur soi qu’un intervenant extérieur se révélera souvent utile. La réussite n’est pas garantie, mais les auteurs ont observé des cas où une réinterprétation raisonnable des outils qu’à l’origine on voulait importer tels quels, comme le Total Quality Management ou même le MBO, s’est soldée par un succès. Un certain volontariat pour s’engager dans les interactions et une coopération suffisamment durable paraissent requis pour que l’apprentissage aboutisse.
Où va-t-on ?
Faut-il conclure sur une note franchement optimiste ? Lecteur qui m’a suivi jusqu’ici, tu me permettras de me référer, exceptionnellement, à une culture régionale (supposée) et de donner une réponse de Normand. La perspective, après la pandémie, d’une multiplication des réunions à distance semble inquiétante : comment minimiser les malentendus lorsque le visage du partenaire est un timbre-poste sur un écran, que les conversations de couloir sont abolies ou que l’humour devient impossible à interpréter ? Ce futur peut faire apparaître la bouteille à moitié vide. Heureusement, la méthode proposée par l’ouvrage est concrète et praticable. Parmi les exemples analysés, les succès sont convaincants et semblent souvent réplicables, mutatis mutandis. Finissons par la bouteille à moitié pleine !