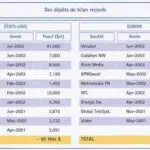Le monde ne vit pas seulement de commerce

Parmi les intérêts communs de l’humanité, la liberté et l’intensité des échanges commerciaux figurent en bonne place. Mais la vigueur et le rayonnement des cultures importent aussi, ainsi que la santé publique à tous les niveaux géographiques, du local au mondial. Et les soucis globaux que crée l’environnement – changement climatique et appauvrissement de la biodiversité en particulier – ne semblent pas près de s’atténuer.
Or qu’il s’agisse de culture, de santé publique, ou encore d’environnement, on observe certaines incompatibilités avec le libéralisme commercial. Il est important de les identifier, d’en évaluer la portée, et d’examiner comment des conflits qui en résultent sont tranchés, le cas échéant comment ils pourraient l’être autrement. C’est ce que nous faisons dans cet article ; évidemment pas de façon exhaustive : nous nous limitons aux enjeux suivants :
- protection de la diversité des cultures, qui est un objectif central de l’Unesco, versus libre commerce des « biens et services culturels » conformément aux principes de l’OMC ;
- recevabilité d’objections scientifiques, en particulier en matière sanitaire, à l’entrée de certains produits, en particulier alimentaires ;
- effets, sur les usages qui sont faits des ressources biologiques des pays en développement, de la généralisation forcée à l’ensemble des pays membres de l’OMC des droits de propriété intellectuelle (principalement les brevets) établis dans les pays développés pour inciter à l’innovation technique.
Les problèmes soulevés par ces trois enjeux ont plus qu’un intérêt théorique ; il peut même arriver qu’ils donnent lieu à des conflits féroces.
Culture et commerce
Au cours des négociations commerciales de l’Uruguay Round, qui s’est terminé en 1994 sur divers accords multilatéraux, dont la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’opposition a été vive entre les partisans de « l’exception culturelle », conduits par le Canada et la France, et ses adversaires, essentiellement les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Aucun accord spécifique n’a été conclu concernant les « biens et services culturels ». Mais beaucoup d’observateurs, en particulier anglo-saxons, étaient persuadés que ce n’était que partie remise, qu’au cours du Round suivant les plus manifestement économiques des « biens et services culturels » seraient incorporés dans le General Agreement on Trade in Services (GATS), persuadés qu’ils rentreraient dans le rang en quelque sorte.
Il ne semble pas que les choses se soient passées ainsi. Les « biens et services culturels » ne jouent aucun rôle significatif dans l’actuel Doha Round, lequel n’a d’ailleurs pas besoin d’une difficulté supplémentaire (voir l’article de Patrick Messerlin dans ce numéro). Et entre-temps (le 20 octobre 2005) la conférence générale d’une autre institution internationale, l’Unesco, a adopté la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Une écrasante majorité de pays membres de l’Unesco (148) ont voté en faveur de la Convention, deux ont voté contre (États-Unis et Israël), quatre se sont abstenus (Australie, Honduras, Liberia, Nicaragua).
Mais les États-Unis se sont déclarés décidés à défaire à l’OMC ce qui venait d’être fait à l’Unesco. Et il est vrai que la Convention comporte des dispositions contraires à certains principes généraux auxquels, du fait même de leur appartenance à l’OMC, les pays membres de cette organisation adhèrent ; et il est vrai aussi qu’il y a à l’OMC des procédures de coercition dont l’Unesco est complètement dépourvue. Le vote à l’Unesco de la Convention par une écrasante majorité est néanmoins un signal fort d’opposition à un traitement purement commercial des « biens et services culturels ». La situation reste donc confuse.
La Convention ne dit évidemment pas qu’il ne doit pas y avoir d’échanges culturels. La diversité qu’elle vise à défendre est au contraire la base même d’échanges qu’on souhaite les plus diversifiés possible. « Il faut bien voir, écrit le professeur néo-zélandais de droit international Michael Hahn1, que les partisans du libre-échange commercial des biens et services culturels ne sont pas particulièrement intéressés à élargir l’éventail des choix pour les consommateurs, mais tendent plutôt à promouvoir une situation de monopole. » Judicieusement il ajoute que certains partisans de l’approche culturelle peuvent avoir de sérieux intérêts financiers à contenir la pression exercée par leurs concurrents américains. Quoi qu’il en soit, la poursuite d’un monopole mondial ne figure assurément pas plus dans les objectifs de l’OMC que dans ceux de l’Unesco.
Les oppositions ne portent pas sur des « biens et services culturels » tels que livres ou tournées de compagnies théâtrales, chorégraphiques ou musicales. Elles portent sur le cinéma et la télévision – des pays comme le Canada, la France et la Corée voulant pouvoir continuer à soutenir les productions nationales par des subventions et des quotas de projection, ce que les États-Unis dénoncent comme contraire aux règles de l’OMC – et toutes les formes d’enregistrement musical ou vidéo. Ces oppositions ne sont pas que de principe.
Ainsi les États-Unis n’ont-ils accepté de commencer avec la Corée des négociations en vue d’un accord bilatéral de libre-échange qu’après que la Corée a le 20 janvier 2006, unilatéralement et « volontairement », divisé par deux (de 146 à 73) le nombre de jours pendant lesquels les cinémas coréens sont tenus de projeter des films coréens. Les États-Unis ont également attaqué en 1996, devant les organes d’arbitrage de l’OMC, certaines modalités de distribution favorisant les magazines canadiens au Canada.
Cependant, ce ne sont là qu’escarmouches. L’incompatibilité entre certains des principes généraux de l’OMC, d’une part, et d’autre part à la fois certaines dispositions de la Convention adoptée à l’Unesco, et les politiques effectives de protection culturelle mises en œuvre par certains pays, pourrait susciter des conflits beaucoup plus sérieux. Jusqu’à présent les pays membres de l’OMC ne les ont pas cherchés, notamment dans le cadre du Doha Round. Au cours des négociations avec le Canada en vue de l’établissement d’une zone de libre-échange (CUSFTA, 1989), les États-Unis ont accepté toutes les « exceptions culturelles » auxquelles les Canadiens sont attachés ; celles-ci ont été reprises sans modification lors de l’extension de la zone au Mexique (NAFTA, 1994). Aucun front n’a été ouvert avec l’Europe en matière culturelle, alors que les différends sérieux ne manquent pas sur d’autres fronts (voir ci-dessous). Si la France a quelque chose à craindre en matière de libéralisation culturelle, il semble que ce ne soit pas des États-Unis (au moins directement), mais du zèle libéralisant indiscriminé2 des autorités de l’Union européenne.
Libre-échange et méthode scientifique
p>En 1997, les États-Unis ont déposé une plainte à l’OMC contre l’Union européenne (UE) qui refusait d’importer de la viande d’animaux traités aux hormones (conflit dit du « bœuf aux hormones »). L’Union européenne soutient que consommer cette viande comporte des risques sanitaires inacceptables. L’organe d’arbitrage de première instance, appelé Panel, a donné sans réserve tort à l’Union européenne : l’argumentation de l’Union européenne n’est, selon lui, recevable que si les risques sont avérés, c’est-à-dire établis rigoureusement selon la démarche scientifique canonique suivie en laboratoire ou lors d’essais cliniques.
L’organe d’appel, auprès duquel l’Union européenne s’est alors pourvue, est plus nuancé. Dans son rapport du 16 janvier 1998, on lit en effet : « Dans la mesure où le Panel réclamait une démarche d’enquête et d’analyse systématique, disciplinée et objective, établissant et distinguant les faits et les opinions, il n’y a rien à redire au rapport du Panel. Cependant, dans la mesure où le Panel prétend exclure du champ de l’évaluation des risques toute matière non susceptible d’une analyse quantitative par les méthodes empiriques ou expérimentales mises en œuvre en laboratoire, nous pensons que le Panel est dans l’erreur. »
La perspicacité que ce texte manifeste ne se retrouve en général pas chez les décideurs confrontés à des incertitudes scientifiques, que ce soit à l’OMC ou au sein de gouvernements nationaux (l’Administration Bush en est encore à réclamer une sound science, totalement assurée, avant de prendre la moindre mesure sérieuse pour freiner le changement climatique). Ces décideurs réclament une science certaine, stabilisée, telle que l’illustre l’exemple suivant. Lorsqu’un faisceau de particules, dans un accélérateur comme celui du CERN, entre en collision à très haute énergie avec une cible de noyaux atomiques, la nature des produits de collision et les trajectoires sur lesquelles ils s’éloignent des points d’impact sont exactement prédites par la mécanique quantique en termes de probabilités objectives, lesquelles sont confirmées par les fréquences statistiques des observations faites dans les chambres à bulles en aval des collisions. Le caractère probabiliste de la théorie en cause, la mécanique quantique, ne doit pas masquer le fait qu’il s’agit bien de science complètement établie et vérifiée, certaine.
C’est en revanche sur la base d’une science qui n’est pas achevée mais qui n’est pas non plus n’importe quel système hypothétique d’explication, que le gouvernement britannique et les autorités européennes ont dû décider dans le contexte suivant, lequel, lui aussi, oppose libre circulation des biens (à l’intérieur de l’Union européenne) et préoccupations sanitaires.
En 1986, l’encéphalopathie spongiforme bovine a été enregistrée pour la première fois chez des vaches anglaises (mais pas en Écosse). La maladie a ensuite progressé à un rythme rapide. Mais le gouvernement britannique maintenait qu’aucune contagion n’était à craindre pour l’homme, en raison du principe de « barrière des espèces ». Ce principe, effectif pour certaines maladies infectieuses, n’avait aucun fondement théorique en biochimie et n’avait jamais été testé expérimentalement dans le cas de l’ESB. Le test vint en 1991, lorsque des chercheurs à l’université de Bristol réussirent à inoculer la maladie à un chat.
Le gouvernement britannique et ses experts se retrouvèrent ainsi sans aucun argument scientifique recevable, fût-il incertain, au moment même où ils devaient affronter une menace beaucoup plus grave que l’ESB : l’apparition d’un nouveau variant de la maladie de Creutzfeld-Jacob (vCJ) frappant des personnes jeunes, alors que la forme traditionnelle n’apparaît que chez des sujets âgés. La maladie de vCJ et l’ESB sont deux maladies neurodégénératives.
Il se fait qu’au même moment un médecin et biochimiste, le professeur Prusiner, étudiait des affections neurodégénératives qui semblaient résulter de désordres dans la conformation de certaines protéines : une série de mutations transformaient des protéines de la famille des prions en pathogènes infectant le cerveau. Dans son laboratoire de l’université de Californie, le professeur Prusiner avait obtenu des résultats expérimentaux remarquables avec des souris et, sur le plan théorique, il avait élucidé certaines des réactions biochimiques responsables des mutations des prions et du pouvoir infectieux des prions dégénérés.
Ces résultats étaient très surprenants, car jamais on n’avait observé la transformation d’une protéine en agent infectieux. Ils étaient en outre encore « provisoires », au sens scientifique de ce qualificatif, et incomplets. Mais ils apparaissaient comme des éléments centraux, et remarquablement innovants, d’un tableau cohérent ; ils étaient en outre les seuls susceptibles d’expliquer l’apparition simultanée de l’ESB et de vCJ. Ils ont valu au professeur Prusiner le prix Nobel de médecine en 1997, c’est-à-dire dans des délais extraordinairement courts ; le jury n’a manifestement pas été arrêté par ce qui restait d’incertitude dans la connaissance des phénomènes déclenchés par les mutations des prions. Ils ont aussi fourni aux autorités britanniques et européennes les bases scientifiques à l’appui de leur décision d’autoriser les pays membres de l’Union européenne à interdire la consommation de viande bovine anglaise.
Ce cas a évidemment de fortes spécificités mais, loin d’être une curiosité marginale, il est représentatif de la complexité et de l’incertitude caractérisant beaucoup de situations critiques auxquelles les décideurs ont aujourd’hui à faire face (voir l’article de Erwann Michel-Kerjan dans ce numéro). Il relève d’une approche de précaution (ce qui ne signifie ni abstention ni démission) bien comprise et bien maîtrisée sur la base de modèles rigoureux ; ces modèles sont récents ce qui peut expliquer les malentendus et les comportements, au sens propre, réactionnaires (comme celui du Panel de l’OMC), qui prédominent3.
Propriété intellectuelle et environnement
Depuis un peu plus de vingt ans, et sous l’impulsion des États-Unis, des titres de protection de la propriété intellectuelle sont de plus en plus facilement accordés dans les pays développés, et les protections qu’ils assurent sont de plus en plus étendues. On accorde de manière routinière des brevets sur des gènes, éléments naturels aussi peu inventés que possible, et quand un gène est couvert par un brevet, ce sont toutes ses fonctions, connues et inconnues, qui passent sous le contrôle du titulaire du brevet. Depuis peu, on accorde des brevets sur des méthodes de gestion ; certes, ce sont des inventions, mais qui peuvent être triviales (comme le one click d’Amazon.com), ou connues, sinon informatisées, depuis des millénaires, comme des règles d’enchères que prétendent monopoliser des entreprises de commerce électronique.
Selon une expression consacrée, l’espace protégé de la propriété intellectuelle est devenu un champ de mines, dans lequel il est malaisé de se mouvoir. Malaisé parce que sans cesse il faut identifier, négocier, payer, pour pouvoir tenter de faire soi-même avancer la connaissance. Dangereux, parce qu’on peut être tenté de braver des brevets douteux, ou qu’on peut ignorer de bonne foi l’existence d’un brevet (il y en a tellement, et certains même sont en toute légalité des brevets cachés), ou mal en mesurer la portée ; nombreuses sont les entreprises qui ont été mises en faillite à la suite d’un procès perdu devant un tribunal spécialisé dans la protection de la propriété intellectuelle, tribunal qui est en général plus porté à confirmer ou défendre un titre de propriété intellectuelle qu’à le révoquer, ou même simplement à reconnaître que celui qui le conteste ou est accusé de l’enfreindre a quelques bonnes raisons de son côté.
Dans ces conditions, il n’est pas excessif d’estimer que le système de protection de la propriété intellectuelle, tel qu’il fonctionne aujourd’hui dans les pays développés et singulièrement aux États-Unis, n’est pas exempt de perversions, qui en diminuent fortement l’utilité économique et sociale, notamment en modifiant les conditions d’exercice de la recherche de base et en entravant le déploiement des politiques de santé publique.
C’est ce système que les pays développés se sont employés à mondialiser, là encore sous l’impulsion des États-Unis.
Au nom de la lutte contre toutes les formes de concurrence déloyale – avec le piratage de produits et de marques comme épouvantail – et du soutien à l’innovation légitime, les États-Unis ont convaincu l’Europe et le Japon, d’abord réticents, de soutenir leurs efforts dans le cadre de l’OMC. Il peut sembler paradoxal de défendre le renforcement de droits de monopole, aussi spécifiques soient-ils, dans le cadre d’une institution internationale créée pour abaisser toutes les barrières commerciales. Mais on pouvait dire qu’il s’agissait de lutter contre des concurrences déloyales.
Et, surtout, les Américains voulaient mobiliser au profit de la protection de la propriété intellectuelle la (relative) rapidité de décision à l’OMC et les capacités d’arbitrage et d’imposition de sanctions que seule, avec le Conseil de sécurité des Nations unies, cette institution internationale possède. Et c’est seulement au sein de l’OMC qu’il était possible de consentir, ou de faire miroiter, des concessions commerciales aux pays en développement en échange de leur acceptation de contraintes de protection de la propriété intellectuelle ; beaucoup avaient conscience qu’elles auraient comme premières conséquences des hausses de prix sur leurs propres marchés et des transferts considérables de ressources financières vers les pays développés, détenteurs d’une majorité écrasante des titres de propriété intellectuelle.
Les concessions commerciales qui intéressaient le plus les pays en développement concernaient les produits agricoles et les textiles ; elles ont, surtout pour les produits agricoles, tardé à venir et sont au cœur du conflit actuel à l’OMC. Les pays développés ont aussi expliqué que l’adoption universelle de règles sérieuses de protection de la propriété intellectuelle favoriserait les investissements et les transferts de technologies au profit des pays en développement, notamment de technologies plus favorables à la protection de l’environnement et du climat que celles couramment utilisées dans ces pays. Des études ultérieures semblent montrer qu’il s’agit largement d’une illusion de plus. D’ailleurs la Chine, qui est de loin le plus grand bénéficiaire d’investissements et de transferts de technologies à partir des pays développés, Amérique en tête, n’a jusqu’à présent jamais rémunéré de manière appréciable, en dépit de son adhésion à l’OMC, la propriété intellectuelle qu’elle reçoit, qu’elle exige, ou dont elle s’empare.
Tant qu’à se laisser imposer la propriété intellectuelle à la mode occidentale, dans le cadre des Accords sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), conclus en 1994 à la Conférence de Marrakech qui a aussi procédé à la création de l’OMC, certains pays en développement ont voulu l’utiliser là où ils ont des connaissances originales. Plusieurs cas spectaculaires de « biopiratage » ne pouvaient que les y inciter davantage. En voici un des plus fameux. Le neem (nom courant indien pour Azadirachta Indica) est un arbre originaire de l’Inde, qu’on trouve aussi en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud. Des textes indiens bimillénaires en vantent déjà les vertus. Avec les feuilles on fabrique un remède contre le paludisme. Des graines on extrait une huile antifongique et insecticide, à spectre large mais inoffensive pour les animaux à sang chaud ; elle est en outre rapidement biodégradable ; elle est largement utilisée par les paysans indiens.
En 1990, la société chimique américaine W. R. Grace dépose aux États-Unis et en Europe des demandes de brevets sur un composé antifongique naturel extrait des graines du neem. Suivent une quarantaine d’autres demandes correspondant à d’autres propriétés de l’arbre. Toutes sont accordées. W. R. Grace devient alors un gros acheteur de graines en Inde, ce qui fait monter les prix hors de portée pour la majorité des paysans indiens. Il est intéressant d’observer qui si des Indiens s’étaient mis en tête de vendre des produits dérivés du neem aux États-Unis, ils ne l’auraient pas pu : c’est la logique de la propriété intellectuelle, ils auraient enfreint les brevets de W. R. Grace, et tous leurs produits auraient été saisis par les douanes américaines. Une vigoureuse campagne internationale a abouti en 2000 à la révocation des brevets de W. R. Grace en Europe, mais pas aux États-Unis.
Pourquoi, s’est-on dit dans plusieurs pays en développement, ne pas prendre les devants, en utilisant les instruments de protection de la propriété intellectuelle imposés d’Occident pour protéger les savoirs traditionnels et les ressources biologiques sur lesquels ils portent ? Cela s’est avéré impossible, ces instruments, les brevets principalement, sont adaptés à la protection des inventions techniques telles qu’elles sont réalisées dans les pays développés, pas à la protection de savoirs traditionnels. Une invention protégée par un brevet correspond à un moment bien identifié sur une trajectoire d’innovation, un savoir traditionnel est un processus qui évolue lentement. Une innovation est le fait d’un inventeur, qui s’identifie en demandant un brevet ; qui peut se présenter comme l’inventeur d’un savoir traditionnel, et comment le prouver ?
Autant d’obstacles, et il y en a d’autres, qui rendent vain l’espoir d’utiliser des instruments de protection conçus dans un tout autre contexte, et qui sont pourtant les seuls qui aient force légale dans le cadre de l’OMC. Il existe bien une Convention sur la diversité biologique (CDB) adoptée à la Conférence des Nations unies sur l’environnement (Rio de Janeiro, 1992). Elle a pour objectif de préserver la biodiversité et son utilisation durable. Elle prévoit le partage équitable des bénéfices qui en découlent. Elle reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources biologiques, et les droits des communautés traditionnelles sur leurs savoirs liés à ces ressources. Mais ce n’est qu’une convention, pas une institution, et elle a encore moins de dents que l’Unesco.
Il n’y a pas que l’équité qui soit en cause dans ce contexte. L’efficacité l’est aussi, c’est-à-dire la possibilité d’utiliser efficacement certaines ressources biologiques au bénéfice des humains. Car incapables de se protéger du biopiratage et d’avoir leur part de l’utilisation de ces ressources, les pays en développement sont de plus en plus portés à interdire leur territoire aux prospecteurs étrangers. Ce qui revient en fait à interdire la prospection par des équipes œuvrant officiellement et de manière transparente, alors que les braconniers, malgré des risques accrus, continuent à opérer clandestinement. Et quant aux technologies favorables à l’environnement qui pourraient être transférées à partir des pays développés, la plupart des pays en développement ne peuvent ni les acheter sous licence, ils n’en ont pas les moyens, ni – contrairement à la Chine qui est capable de résister aux pressions des propriétaires de brevets – les imiter sans contrepartie. Il y a bien les « mécanismes de développement propre » prévus dans le protocole de Kyoto, mécanismes qui peuvent inciter des entreprises européennes à transférer des technologies susceptibles de réduire les émissions de CO2 ; mais leur mise en œuvre reste encore limitée. L’économiste Jagdish Bagwhati, professeur à l’université Columbia, un des meilleurs spécialistes et un des partisans les plus déterminés de la libéralisation commerciale, n’avait pas tort de prédire qu’on ne peut que difficilement surmonter la contradiction entre l’ouverture de la libéralisation, première mission de l’OMC, et la fermeture des ADPIC, mission ambiguë imposée par les États-Unis.
1. Hahn, M., « A Clash of Cultures ? The Unesco Diversity Convention and International Trade Law », Journal of International Economic Law, 9 (2006) 515–552 (citation p. 521).
2. Indiscriminé est par exemple l’acharnement de la Commission européenne à vouloir imposer, au nom de la concurrence dans le grand marché en Europe, des opérateurs américains de jeux d’argent à peine tolérés aux États-Unis.
3. Voir Henry, C., Decision-Making under Scientific, Political and Economic Uncertainty, Cahier DDX-06–12 de la Chaire du développement durable École polytechnique-EDF, disponible sous HYPERLINK http://ceco.polytechnique.fr/CDD/PDF/DDX-06–12.pdf ; à paraître dans un volume édité par l’Académie des sciences de Suède.